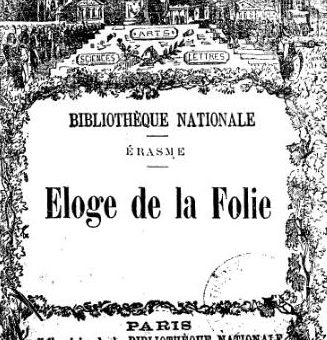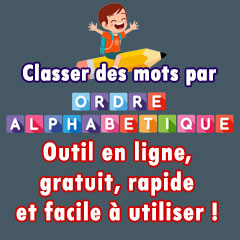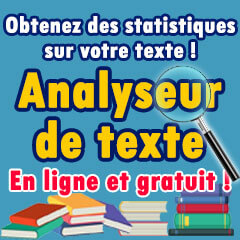Catégorie : Genres littéraires
La parodie est l’imitation burlesque d’un texte littéraire. Pour les anciens Grecs, c’était l’imitation comique d’un poème sérieux. L’appellation s’est ensuite appliquée aux imitations comiques d’œuvres historiques et de fictions, à des écrits scientifiques et à toutes les autres œuvres en prose.
L’épigramme est une petite pièce de poésie qui présente, avec grâce et précision, une pensée délicate, fine, ingénieuse, quelquefois naïve, mais le plus souvent mordante et satirique et toujours intéressante.
L’éloge (du latin elogium, dire du bien, louer) est une expression de l’estime que l’on fait des personnes ou des choses. Ce mot est synonyme de louange.
Le roman policier est né au XIXe siècle. Il exprime des peurs nouvelles, liées à l’extension d’une pauvreté urbaine figurée sous la plume d’auteurs comme Charles Dickens (Oliver Twist, 1837-1838), Honoré de Balzac (Une Ténébreuse Affaire, 1841), Victor Hugo (Les Misérables, 1862)…
L’autobiographie est un genre littéraire, qui se présente comme la biographie d’une personne réelle faite par elle-même.
Le mot farce (bas-latin farsa, de farcire, farcir), désigne essentiellement un mélange. C’est une pièce de théâtre d’inspiration bouffonne mettant en scène des personnages souvent grotesques et présentant généralement un comique de mots, de gestes ou de situation(s).
Germain-Étienne Coubard d’Aulnay explique pourquoi il est important de lire et de faire réciter des fables, surtout celles de La Fontaine…
En ce début du XVIIe siècle, le théâtre apparaît comme le domaine privilégié de l’outrance baroque. Les partisans de la liberté totale d’inspiration et de composition l’emportent alors largement.
Parmi les genres théâtraux, on distingue : La tragédie – La comédie – L’opéra-comique – La farce – Le drame – Le vaudeville – Le théâtre de boulevard
Le texte de théâtre n’est pas écrit pour être lu, mais pour être joué. Il est donc nécessaire de procéder à une interprétation qui permette de comprendre comment passer de l’écriture à la représentation.
De nos jours, le prologue (théâtre) se présente surtout comme un moyen de faire connaître dramatiquement, et non par forme de récit, des faits antérieurs au temps où s’accomplira l’action principale de la pièce.
Les conflits théâtraux varient selon les époques, les auteurs et le genre de l’œuvre.
Pour faire rire, on peut jouer sur le geste, la situation, les mots, le caractère ou les mœurs.
À la différence du roman, le théâtre fait assister à l’action. Pour que le spectateur puisse voir les choses, comme si elles arrivaient devant lui, le XVIIe siècle impose peu à peu la règle des trois unités.
Tragique ou heureux, le dénouement achève la pièce. Comme son nom l’indique, il dénoue l’action et, à travers une dernière parole et action, inscrit un ultime sens dans l’esprit du spectateur.
La scène d’exposition, très souvent la première scène, apporte les informations indispensables pour situer l’action, identifier les personnages, reconnaître le conflit. On distingue quatre types d’exposition.
Au théâtre, le texte écrit par l’auteur est constitué principalement des dialogues prononcés par les personnages. Indispensable à la compréhension de l’intrigue, la parole est au centre de l’action théâtrale.
La tragédie est une œuvre dramatique en vers, dont la composition est soumise à des règles strictes (les trois unités), qui met en scène des personnages illustres, tirés de l’Antiquité grecque ou romaine, qui fait reposer l’action sur des conflits passionnels dans lesquels les personnages sont déchirés et implacablement entraînés vers une catastrophe ou un destin désastreux.
Le conte est un récit court (en prose ou en vers), un récit de faits qui pose un regard sur la réalité par le biais du merveilleux ou du fantastique. Le conte est généralement destiné à distraire, à instruire en amusant…
Le terme biographie (du grec bios, « vie », et graphein, « écrire »), histoire de la vie d’un personnage, est apparu seulement au XVIIIe siècle, mais il correspond à un genre littéraire très ancien.