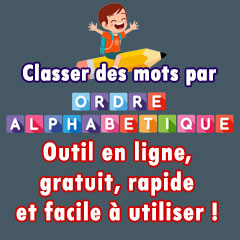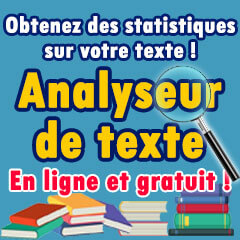Construire un dialogue
Leçons d’expression ► vous êtes ici
Expression
Construire un dialogue
Sommaire
Présentation
Souvent, dans un texte narratif, des passages de récit alternent avec des passages au discours direct. Le discours direct peut rapporter les paroles d’un personnage (c’est un monologue), ses pensées (c’est un monologue intérieur), ou l’échange de paroles entre plusieurs personnages, rapportées au style direct : c’est cette situation qu’on appelle un dialogue.
Chaque personnage qui prend la parole est un locuteur. Le dialogue s’exerce donc entre plusieurs interlocuteurs.
→ À lire : Le système énonciatif. – Le vocabulaire de la communication.
La mise en page du dialogue
Pour faire voir au lecteur le changement des interlocuteurs dans un dialogue, on sépare les répliques. Chacune correspond à un retour à la ligne, chacune est introduite par un tiret.
Exemple : – Est-ce que tu aurais l’intention de passer la nuit sur ce banc ? reprit l’homme.
– Oui, si cela me convient, répliqua Michel Strogoff d’un ton un peu trop accentué pour le simple marchand qu’il devait être.
Les dialogues sont les seuls textes à être disposés de cette façon sur la page. Cette disposition est tellement particulière, tellement nette que, souvent, on se dispense d’utiliser les guillemets au début et à la fin des dialogues.
⚠ La première réplique d’un dialogue est dispensée de tiret.
La ponctuation expressive
Le passage du récit au discours direct est signalé par les deux points. Le texte qui est au discours direct est encadré par des guillemets. En plus, de cette ponctuation mise pour faciliter la lecture, le dialogue utilise une ponctuation expressive abondante et variée.
Toutes les sortes de points de ponctuation se rencontrent dans les dialogues car tous les types de phrases y sont utilisés.
Exemples : – Qu’est-ce que tu fais là ? → Phrase interrogative.
– Approche donc qu’on te voie ! → Phrase impérative.
Cette variété des points à l’écrit correspond à la variété des tons utilisés à l’oral par les interlocuteurs.
Les points de suspension marquent l’inachèvement de la phrase ou les hésitations du locuteur.
⚠ Par de nombreux moyens, l’écrit cherche à transmettre toutes les nuances des tons de l’oral, entre autres :
1. La succession de signes de ponctuation : – Qu’est-ce que c’est cette histoire ?!…
2. La variété des verbes de parole qui accompagnent le dialogue : affirmer, répéter, s’écrier, murmurer, répondre, répliquer…
Les propositions incises
La lecture d’un dialogue est parfois difficile car on ne sait plus quel locuteur s’exprime. Celui qui écrit alors recourt à des propositions incises, qui désignent celui ou celle qui parle.
Exemple : Je me repose, répondit Michel Strogoff.
Ces propositions incises sont généralement courtes. Elles permettent souvent de donner des indications sur le ton, l’attitude, les gestes du locuteur.
Exemple : Oui, si cela me convient, répliqua Michel Strogoff d’un ton un peu trop accentué pour le simple marchand qu’il devait être.
Les propositions incises, qui s’intercalent dans le dialogue, sont de type récit. C’est pour cette raison que les temps des verbes y sont différents de ceux que l’on rencontre dans l’échange de paroles, qui est du type discours direct.
Le dialogue de théâtre
Il y a quelques différences entre l’écriture d’un dialogue de roman et celle d’un dialogue de théâtre. Dans ce dernier, l’indication du nom des personnages figure au début des répliques. Les indications sur le ton, les gestes, les déplacements des personnages sont donnés avant le texte, ou au début des répliques, ou au fil du texte entre parenthèses. On appelle ces indications des didascalies. Il n’y a donc pas de propositions incises dans un dialogue de théâtre. Celui-ci est encore plus proche du dialogue oral.
→ À lire : Le texte théâtral : La parole sur scène.
|
Articles connexes
- Les verbes de parole.
- Le discours rapporté.
- La transformation du discours direct en discours indirect.
- Le vocabulaire de la communication.
- La parole sur scène.
- Le monologue intérieur.
- Les tonalités.
- La ponctuation.
- Le système énonciatif.
- Les figures de style.
- Le style littéraire.
- Analyser un mot. – Analyser une phrase. – Analyser un texte.
- Autres rubriques : Grammaire. – Conjugaison. – Vocabulaire. – Orthographe. – Expression.
Suggestion de livres
 Le Grevisse de l’enseignant – 1000 exercices de grammaire Le Grevisse de l’enseignant – 1000 exercices de grammaire |  Le Bon usage Le Bon usage |
 Bescherelle – Le coffret de la langue française Bescherelle – Le coffret de la langue française |  Écrire sans fautes – Orthographe – Grammaire – Conjugaison Écrire sans fautes – Orthographe – Grammaire – Conjugaison |
[➕ Autres choix…]