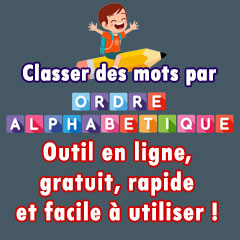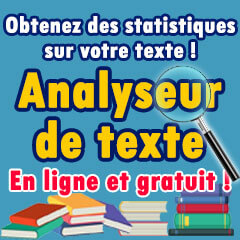L’invention de l’école : entre histoire et légende
Lumière sur… / Histoires / Éducation et enseignement ► vous êtes ici
Histoires / Lumière sur…
L’invention de l’école :
entre histoire et légende
Sommaire
Présentation
« Qui a eu cette idée folle un jour d’inventer l’école ? C’est ce sacré Charlemagne ! » Cette ritournelle, popularisée par France Gall en 1964, est ancrée dans la mémoire collective française. Bien qu’elle soit chantée avec humour, elle véhicule une idée tenace : Charlemagne serait l’inventeur de l’école. Cette croyance, largement partagée, mérite d’être examinée à la lumière de l’histoire de l’éducation. D’où vient ce mythe ? Que savons-nous réellement du rôle de Charlemagne dans le développement de l’enseignement en Europe ? Et surtout, qui sont les véritables fondateurs de l’école telle que nous la connaissons aujourd’hui ?

⬆ Charlemagne examinant un manuscrit latin sous les voûtes de son palais, tandis qu’un maître enseigne à de jeunes élèves dans une école monastique carolingienne. Une représentation symbolique de la réforme éducative de l’époque. Image imaginée et créée par l’IA.
→ À lire : Histoires. – Éducation et enseignement.
Origines antiques de l’école
L’instruction organisée ne date pas du Moyen Âge. Les premières écoles apparaissent dès que l’écriture existe : chez les Sumériens (Mésopotamie) vers 3500 av. J.-C., on crée les « maisons des tablettes » (edubba) reliées aux temples pour former les scribes. En Égypte ancienne, des écoles de temple forment à l’écriture hiératique et au calcul les enfants d’élites (nobles, prêtres, scribes) dès l’âge de 5 ans. En Grèce antique, l’éducation des garçons comprend dès 7 ans la lecture (souvent Homère), l’écriture et le calcul chez le grammatiste, puis la musique et le sport au gymnase (les filles apprennent surtout à domicile ou dans des écoles religieuses). Dans la Rome antique, les fils de patriciens suivent un cycle tripartite : ludus (7–11 ans) pour lire, écrire, compter, puis grammatica (11–15 ans) pour étudier la littérature et la rhétorique, et seuls les plus doués vont chez le rhéteur. En Chine, l’enseignement est dominé par les classiques confucéens : Confucius (VIe‑Ve s. av. J.-C.) jette les bases de l’éducation chinoise, et sous les Han (IIe s. av. J.-C.) le confucianisme devient doctrine d’État. En Inde, la tradition du gurukula (discipulat vedique dans l’ashram du maître) existe dès le 1er millénaire av. J.-C. (les Upanishads mentionnent plusieurs gurukulas, comme celui du sage Drona). De grandes universités antiques s’y développent : Takṣaśilā (Taxila, Ve s. av. J.-C.) est considérée comme un centre d’enseignement supérieur majeur, tout comme l’université bouddhique de Nālandā (Bihar, du Ve au XIIe siècle) réputée dans tout le sous-continent. Enfin, dans le monde islamique médiéval, des écoles coraniques (kuttab) et des madrasas enseignent le Coran, le droit et les sciences. Par exemple, l’université Al-Qarawiyyīn de Fès, fondée en 859, est la plus ancienne université encore en activité dans le monde. Les madrasas médiévales, quant à elles, couvrent aussi bien la théologie et la jurisprudence que la grammaire, les mathématiques ou la médecine.
Charlemagne et les réformes carolingiennes
La statue équestre de Charlemagne devant Notre-Dame rappelle que son règne (768‑814) a profondément marqué l’éducation. Conseillé par l’érudit Alcuin, Charlemagne fonde à Aix-la-Chapelle une école du Palais où l’on enseigne les sept arts libéraux (grammaire, dialectique, rhétorique, arithmétique, géométrie, musique, astronomie). Par son capitulaire Admonitio generalis de 789, il ordonne surtout de restaurer et normaliser les écoles monastiques et épiscopales (jusque-là négligées) dans tout l’empire. En réalité, il ne crée pas l’école ex nihilo : la Gaule romaine disposait déjà de « petites écoles » municipales (école primaire, secondaire et rhétorique) héritées de Rome. Autrement dit, Charlemagne organise et relance l’instruction (notamment des clercs et de l’administration impériale), mais il est absurde d’en conclure qu’il aurait inventé l’école.
Le mythe carolingien dans la culture populaire
La légende selon laquelle « Charlemagne a inventé l’école » est forgée et entretenue plus tard. Déjà au IXe siècle, le moine Notker de Saint-Gall invente une anecdote (Charlemagne testant les écoliers) pour magnifier l’empereur. Plus près de nous, la chanson populaire Sacré Charlemagne (France Gall, 1966) a diffusé le refrain « C’est ce sacré Charlemagne… qui a eu cette idée folle un jour d’inventer l’école ». Même des manuels scolaires du XXe siècle y participent : l’un d’eux décrit Charlemagne créant des écoles dans chaque ville, avant de conclure à juste titre « Charlemagne n’a pas inventé l’école. L’enseignement existait bien avant lui ». En somme, des récits fantaisistes (Notker, chansons, manuels) et la volonté républicaine d’un « roman national » ont ancré l’idée d’un fondateur unique. Des historiens de la IIIe République reconnaissaient d’ailleurs eux-mêmes qu’ils avaient largement contribué à diffuser le « mythe carolingien » fondateur de l’école.
De la Réforme protestante à l’école moderne
Réforme protestante (XVIe s.)
Luther et Melanchthon élèvent le maître d’école au rang de sacerdoce et exigent l’instruction universelle. Ils demandent l’ouverture d’écoles populaires pour tous (garçons et filles), visant à ce que chacun puisse lire la Bible. En Saxe et en Allemagne luthérienne, Melanchthon organise ainsi un réseau d’écoles primaires obligatoires, publiques et gratuites.
Humanistes et Lumières (XVIIe – XVIIIe s.)
Des intellectuels comme Fénelon puis des philosophes des Lumières (Rousseau, Condorcet, etc.) mettent l’éducation au cœur de leur projet sociétal. Condorcet, en 1792, pose les bases d’un système national d’instruction primaire visant à éduquer tous les citoyens.
Révolution française et Empire
La Révolution de 1789 affirme le principe d’égalité devant l’éducation. Napoléon, sur cette lancée, crée des lycées pour former une élite et fonde en 1806 l’Université impériale (centralisant l’enseignement supérieur) pour unifier les programmes.
XIXe siècle en France
Après 1815, plusieurs lois encadrent l’école primaire : la loi Guizot (1833) oblige chaque commune à maintenir au moins une école de garçons; la loi Falloux (1850) libéralise l’enseignement religieux; et Victor Duruy (1867) crée les premières écoles publiques destinées aux filles. Ce mouvement s’inscrit dans une scolarisation de masse croissante.
L’école publique, laïque et obligatoire (IIIe République)
La IIIe République consacre la gratuité et la laïcité de l’instruction. Les lois Jules Ferry (1881-1882) institueront l’école primaire gratuite, laïque et obligatoire pour tous les enfants. L’enseignement religieux disparaît alors des programmes publics, remplacé par l’instruction morale et civique. Il faut noter que la scolarisation était déjà très avancée : à la veille des lois Ferry la quasi-totalité des enfants fréquente l’école primaire. Cependant, c’est avec Ferry que l’« école républicaine » d’État s’impose officiellement comme service public. Ce socle légal scelle l’égalité d’accès à l’éducation laïque pour toute la population.
Représentations contemporaines et enseignement critique
Aujourd’hui encore, l’imaginaire scolaire foisonne de figures mythiques (Charlemagne, Napoléon, Jules Ferry, Rousseau, etc.). Plutôt que d’en retenir des légendes simplistes, il importe de replacer l’école dans son histoire réelle. Par exemple, les programmes devraient insister sur la longue préhistoire de l’école (Mésopotamie antique, traditions islamique et asiatique, etc.) et sur les réformes progressives (de Luther à Condorcet, puis les lois du XIXe siècle). En classe, on peut croiser sources primaires (capitulaires carolingiens, écrits des Lumières, textes législatifs…) avec des récits populaires (chansons, manuels anciens) afin de distinguer faits et mythes. Une telle démarche critique aide à comprendre que l’école n’a pas été l’idée d’un seul homme, mais un long processus pluri-millénaire d’invention et de réforme.
Pour conclure…
Charlemagne n’a pas inventé l’école. Il l’a réformée, consolidée, et a contribué à l’essor d’un réseau éducatif chrétien dans l’Europe médiévale. L’idée d’un Charlemagne fondateur de l’école relève plus du mythe que de l’histoire. Toutefois, ce mythe témoigne de l’importance symbolique que l’on accorde à l’éducation dans notre culture.
L’école, telle qu’elle existe aujourd’hui, est le fruit d’un lent processus historique, façonné par des civilisations diverses, des penseurs éclairés, des engagements politiques et des luttes sociales. Si Charlemagne n’en est pas le père, il fait partie des bâtisseurs d’un édifice qui, génération après génération, continue d’évoluer au service du savoir et de la liberté.
Articles connexes
- Histoire de la France : Chronologie abrégée – L’Antiquité – Le Moyen Âge – L’Ancien Régime – La Révolution – Le XIXe siècle – Le XXe siècle.
- Œuvres littéraires du XXe siècle. – Auteurs du XXe siècle.
- Littérature et engagement au XXe siècle.
- Histoire de la littérature française : Le Moyen Âge. – Le XVIe siècle. – Le XVIIe siècle : l’âge baroque – l’âge classique. – Le XVIIIe siècle. – Le XIXe siècle. – Le XXe siècle.
- Charlemagne.
- Lumière sur les symboles de la République française.
- Rubrique à consulter : Histoires. – Éducation et enseignement. – Lumière sur…
Suggestion de livres
 |  |
 |  |
[➕ Autres choix…]