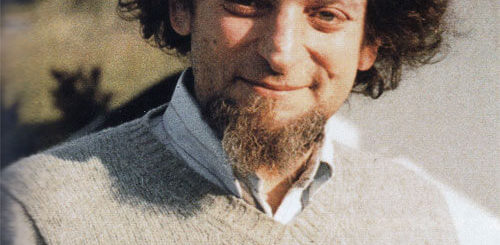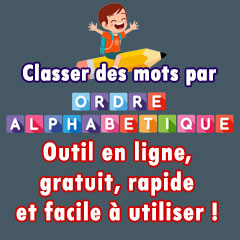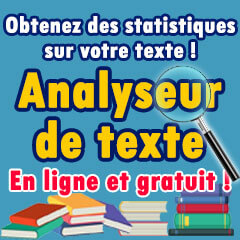La tradition orale
Lumière sur… ► vous êtes ici
Lumière sur…
La tradition orale
Sommaire
Présentation
L’écrit n’a pas toujours été le principal moyen de conserver et de transmettre les récits et le savoir d’une civilisation. De nombreux contes et légendes, mais aussi des principes religieux ou même des lois ont traversé les siècles à travers la parole. C’est ce qu’on appelle la tradition orale.
La tradition orale est donc la préservation et transmission de la culture par le moyen de la communication orale. Dans les régions où l’écriture est d’origine récente, la littérature orale garde encore son importance. Elle englobe aussi bien les contes et les légendes populaires que les récits épiques et les généalogies royales.

⬆ La tradition orale — Représentation d’une scène de tradition orale, où le savoir ancestral est transmis de vive voix par un aîné à la jeune génération. Ce mode de transmission, fondé sur la mémoire collective, joue un rôle central dans la préservation des cultures, notamment dans les sociétés à tradition orale.
Les maîtres de la tradition orale
L’histoire de l’Europe, antérieure à la conquête romaine, n’a longtemps été connue qu’à travers les seuls écrits de l’Antiquité gréco-romaine, puis à travers les récits, rédigés en latin, des hommes d’église des pays concernés. Il en a été de même pour l’Afrique dont les seules sources écrites ont été celles des chroniqueurs arabes du Moyen Âge, qui tenaient leurs informations de voyageurs, puis des commerçants européens. La population, qui n’avait pas accès à l’écrit en raison de l’absence d’écriture, conservait la connaissance des siècles passés dans une littérature orale abondante.
À cet égard, l’exemple de la Scandinavie, qui a été l’une des dernières régions d’Europe à se convertir au christianisme (XIe siècle environ), montre comment des civilisations dépourvues d’écriture ont perpétué les traditions nécessaires au fonctionnement de l’État, les croyances populaires s’enracinant dans les épopées. Premiers à posséder un Parlement (thing) votant des lois (Pingwellir, Islande, XIe siècle), les anciens Danois préservent celles-ci dans la mémoire d’un « gardien des lois » dont le rôle est de les connaître par cœur et à qui on fait appel en cas de contestation. La fonction de ce personnage chargé de « dire la loi » se transmet au cours de l’histoire. En Angleterre, héritière de plusieurs institutions vikings, elle donne naissance au speaker, nom donné au président du Parlement.
Les bibliothèques orales
Dans la plupart des civilisations, ces gardiens de la mémoire des États sans écriture sont nombreux à la cour des souverains où ils jouent le rôle de bibliothèques, chargées, en premier lieu, de conserver les généalogies royales, sources de la légitimité. Au service du pouvoir, ils sont, comme les textes, soumis à la censure, et servent ceux dont ils étaient chargés de chanter les louanges ou de présenter un arbre généalogique favorable. De même, les grands récits fondateurs sur lesquels s’appuient les prêtres (les druides chez les Celtes) pour assurer la cohésion du peuple et donner des fondements aux rites (fête des solstices par exemple) doivent répondre à une stricte orthodoxie. La christianisation en Europe et l’islamisation en Afrique se substituent aux grands personnages mythiques et aux génies bienfaiteurs de la nature (sources, rochers) à travers le culte des saints et leurs spécialisations (maladie, récolte, fécondité, etc.).
→ À découvrir : Mythologies et mythes.
Le recueil des traditions orales
Très tôt, l’écriture a permis de sauvegarder les grands mythes de l’humanité. Ainsi, des fragments en sumérien et en akkadien, aux contenus parfois complémentaires, gravés sur des tablettes d’argile cuite datant du IIIe millénaire av. J.-C., transcrivent l’Épopée de Gilgamesh, personnage de la mythologie assyro-babylonienne. Ils évoquent l’histoire du Déluge, reprise en hébreu dans les premiers livres de la Bible. Dans le monde grec, l’Iliade et l’Odyssée sont des récits historiques et mythiques consignés par Homère (VIIIe siècle av. J.-C.), et passés dès cette époque dans la littérature écrite. De même, la diffusion de l’arabe littéraire et l’expansion du commerce musulman dans l’océan Indien sont à l’origine des Mille et Une Nuits (Xe siècle), recueil de vieux contes populaires (Ali Baba ou Hadji Baba) et de récits de marins (Sindbad) datant de l’époque préislamique et de l’antique route des épices et des aromates.
En Europe, les relations avec l’Orient et l’accès aux textes de la Grèce ancienne sont à l’origine des Fables d’Ésope (Phrygie, IVe siècle av. J.-C.) — qui inspireront plus tard à Jean de La Fontaine ses Fables (1668) —, mais que l’on trouve sous différentes variantes probablement plus anciennes encore en Inde et en Afrique.
Le premier recueil raisonné des traditions orales est l’œuvre des frères Grimm avec les Contes d’enfants et du foyer (Blanche-Neige et les sept nains, Hänsel et Gretel, 1812-1815). Ils précèdent les folkloristes qui se penchent sur la culture populaire dont les traditions orales, les fêtes et les rites sont porteurs de civilisation et d’histoire. Leur étude systématique est à mettre au compte des ethnographes, dont la discipline, branche de l’anthropologie, se propose de « faire connaître à tous les points de vue des différentes races humaines » (Armand de Quatrefages de Bréau, 1869). Le premier des grands folkloristes ethnographes est Arnold Van Gennep dont les Rites de passage (1909), synthèse établie d’après des enquêtes ethnographiques, ouvrent la voie à de nombreuses recherches dans les régions où la tradition orale reste vivante à défaut d’une pratique ancienne de l’écriture.
L’Afrique, continent des traditions orales
En Afrique, particulièrement en Afrique subsaharienne, la tradition orale gouverne la vie quotidienne des populations rurales jusqu’à la multiplication des postes de radio dans les années cinquante, l’écriture étant réservée aux lettrés en milieu islamisé (depuis le XIe siècle environ) et à une petite élite de cadres administratifs sous la colonisation depuis le début du siècle. La connaissance des traditions et leur diffusion sont réservées aux griots, une caste dotée d’un statut à part, le terme recouvrant aussi bien le généalogiste royal que le conteur traditionnel. Les missions de Marcel Griaule, entreprises à la veille de la Seconde Guerre mondiale et portant notamment sur les mythes dogon et bambara, donnent lieu au célèbre Dieu d’eau (1948), une transcription de la cosmologie dogon.
Les recueils de traditions orales, aidés par l’existence du magnétophone, se multiplient. Mais, en raison du développement économique qui ouvre les régions isolées au monde extérieur (migrations temporaires, exode rural, essor de la radio), les récits du passé se trouvent soumis à des altérations de plus en plus importantes. Ainsi, des récits traditionnels adaptés pour la radio avec les additifs nécessaires à leur dramatisation, ou des théories historiques nouvelles, se trouvent intégrés dans les récits oraux comme issus de la parole des ancêtres. C’est pourquoi Amadou Hampâté Bâ, formé à la pensée scientifique et humaniste de Théodore Monod — qui lui a ouvert les portes de l’Institut fondamental d’Afrique noire (IFAN), à Dakar — a lancé son célèbre appel de l’Unesco :
En Afrique, quand un vieillard meurt, c’est une bibliothèque qui brûle !
Extrait : Dieu d’eau de Marcel Griaule (préface)
Dans Dieu d’eau (1948), Marcel Griaule rapporte ses trente-quatre journées d’entretiens avec Ogotemmêli, vieux chasseur dogon devenu aveugle après un accident. Ce témoignage détaillé révèle l’existence d’un système cosmogonique complexe, imprégnant l’ensemble des représentations, des activités sociales et rituelles des Dogons, et, montrant de façon éclatante la richesse et la profondeur que la pensée des peuples sans écriture peut atteindre. Dans sa préface, l’ethnologue revient sur les conditions dans lesquelles s’est effectuée cette « découverte ».
Dans l’un des chaos de roches les plus étonnants de l’Afrique, vit une population de paysans-guerriers qui fut l’une des dernières du domaine français à perdre son indépendance.
Pour la plupart des Blancs de l’Afrique occidentale, les Dogon sont de dangereux hommes, sinon les plus arriérés de la Fédération. Ils passent pour pratiquer encore des sacrifices humains et pour se défendre d’autant mieux contre les influences extérieures qu’ils habitent un pays difficile. Des littérateurs ont raconté leurs petites peurs lors d’excursions supposées téméraires. D’après ces légendes et sous prétexte de révoltes dues souvent à des malentendus, on a parfois tenu en exil des villages entiers.
En bref, les Dogon représenteraient l’un des plus beaux exemples de primitivité farouche et cette opinion est partagée par certains Noirs musulmans qui, intellectuellement, ne sont pas mieux outillés que les Blancs pour apprécier ceux de leurs frères fidèles aux traditions ancestrales. Seuls les fonctionnaires qui ont assumé la lourde tâche d’administrer ces hommes ont appris à les aimer.
L’auteur de ce livre et ses nombreux coéquipiers fréquentent les Dogon depuis une quinzaine d’années. Ils ont publié sur ces hommes des travaux qui en font actuellement le peuple le mieux connu du Soudan français : Les Âmes des Dogon (G. Dieterlen, 1941), Les Devises (S. de Ganay, 1941), Les Masques (M. Griaule, 1938) ont apporté à l’érudition la preuve que les Noirs vivaient sur des idées complexes, mais ordonnées, sur des systèmes d’institutions et de rites où rien n’est laissé au hasard ou à la fantaisie. Ces travaux, il y a déjà dix ans, attiraient l’attention sur des faits nouveaux concernant la « force vitale » dont les sociologues nous entretiennent depuis un demi-siècle. Ils démontraient l’importance primordiale de la notion de personne, elle-même liée à celle de société, d’univers, de divinité.
Ce faisant, l’ontologie dogon ouvrait des horizons aux ethnologues et plaçait le problème sur un plan plus vaste.
Par ailleurs tout récemment (1945), un livre retentissant sur La Philosophie bantoue (R. P. Tempels) analysait des notions comparables et posait la question de savoir si l’on doit « prêter à la pensée bantoue un système philosophique ».
Par effets de persévérance et de méthode, quinze années après les premiers pas faits dans les rochers des Falaises de Bandiagara, à cette question il peut être répondu en ce qui concerne les Dogon : ces hommes vivent sur une cosmogonie, une métaphysique, une religion qui les mettent à hauteur des peuples antiques et que la christologie elle-même étudierait avec profit.
Cette doctrine, un homme vénérable l’a confiée à l’auteur. Ogotemmêli, d’Ogol-du-Bas, chasseur devenu aveugle par accident, devait à son infirmité d’avoir pu longuement et soigneusement s’instruire. D’une intelligence exceptionnelle, d’une habileté physique encore visible malgré son état, d’une sagesse dont le prestige s’étendait dans tout son pays, il avait compris l’intérêt des travaux ethnologiques des Blancs et il avait attendu pendant quinze ans l’occasion de révéler son savoir. Il voulait sans doute que ces Blancs fussent déjà au fait des institutions, des coutumes et des rites les plus importants.
En octobre 1946, il manda chez lui l’auteur et, durant trente-trois journées, des entretiens inoubliables se déroulèrent, mettant à nu l’ossature d’un système du monde dont la connaissance bouleversera de fond en comble les idées reçues concernant la mentalité noire comme la mentalité primitive en général.
On serait tenté de croire qu’il s’agit d’une doctrine ésotérique. D’aucuns ont même avancé, à première vue et sans attendre de précisions, qu’il y avait là spéculation individuelle d’intérêt secondaire. Ce sont d’ailleurs les mêmes qui jugent bon de passer une vie sur les idées apparemment personnelles de Platon ou de Julien d’Halicarnasse.
Bien qu’elle ne soit connue, dans son ensemble, que des anciens et de certains initiés, cette doctrine n’est pas ésotérique puisque chaque homme parvenu à la vieillesse peut la posséder. D’autre part, des prêtres totémiques de tous âges connaissent les parties correspondant à leur spécialité. Bien plus, les rites afférant à ce corps de croyances sont pratiqués par le peuple entier.
Certes, ce peuple n’a pas toujours la connaissance profonde de ses gestes et de ses prières, mais en cela il ressemble à tous les peuples. On ne saurait taxer d’ésotérisme le dogme chrétien de la transsubstantiation sous prétexte que l’homme de la rue ignore ce mot et n’a que des lueurs sur la chose.
Une réserve de même sorte pourrait être faite concernant la valeur explicative et représentative de cette doctrine, concernant la mentalité noire en général. On pourrait avancer que ce qui vaut pour les Dogon ne vaut point pour les autres populations du Soudan.
À cela, l’auteur et ses coéquipiers répondent avec assurance : la pensée Bambara repose sur une métaphysique aussi ordonnée, aussi riche et dont les principes de base sont comparables à ceux qu’utilisent les Dogon. Les travaux de Mme G. Dieterlen et de Mme de Ganay en apportent le témoignage. Il en est de même des Bozo, pêcheurs du Niger, des Kouroumba, cultivateurs du centre de la Boucle, des énigmatiques Forgerons des mêmes régions, chez lesquels les enquêtes ne font que commencer.
Il ne s’agit donc point ici d’un système de pensée insolite, mais bien du premier exemple d’une suite qui sera longue.
Ce faisant, l’auteur souhaite atteindre deux buts : d’une part, mettre sous les yeux d’un public non spécialiste, et sans l’appareil scientifique habituel, un travail que l’usage réserve aux seuls érudits ; d’autre part, rendre hommage au premier Noir de la Fédération occidentale qui ait révélé au monde Blanc une cosmogonie aussi riche que celle d’Hésiode, poète d’un monde mort, et une métaphysique offrant l’avantage de se projeter en mille rites et gestes sur une scène où se meut une multitude d’hommes vivants.
Marcel Griaule, Dieu d’eau, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1966.
Articles connexes
- Rubriques du site : Lumière sur… – Littérature. – Histoires. – Mythologies et mythes.
- Genres littéraires » Le conte. – Le conte merveilleux. – Le conte philosophique.
- Histoire de la littérature française.
- Histoire de la France.
Suggestion de livres
 |  |
 |  |
[➕ Autres choix…]