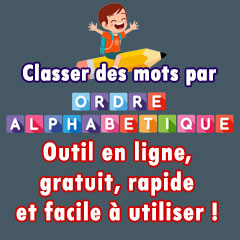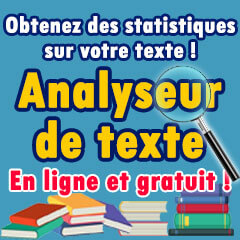Le h aspiré et le h muet
Leçons d’orthographe ► vous êtes ici
Le h aspiré et le h muet
Sommaire
💡 La lettre h – (H) est aspirée ou muette, lorsque dans la même syllabe elle est seule avant une voyelle. Muette ou aspirée, cette lettre ne représente aucun son en français. De plus, le « h » peut servir également à fabriquer certains digrammes, comme ch et ph (chemin, photo). 💡
Le « h » est aspiré
Si la lettre « h » est aspirée, comme dans héros, hameau, elle donne au son de la voyelle suivante une articulation gutturale, et alors elle a les mêmes effets que les autres consonnes : au commencement du mot, elle empêche l’élision1 de la voyelle finale du mot précédent, ou elle rend muette la consonne finale.
Exemple : On écrira la haine et non pas l’haine ; la honte et non pas l’honte parce que le « h » est aspiré. (Jean-François Marmontel et Nicolas Beauzée, Encyclopédie méthodique, La lettre H, 1782-1786)
Le « h » muet
Si la lettre « h » est muette, comme dans homme, harmonie, elle n’indique aucune articulation pour le son de la voyelle suivante, qui reste dans l’état actuel de simple émission de la voix ; et, dans ce cas, elle n’a pas plus d’influence sur la prononciation, que si elle n’était point écrite ; ce n’est alors qu’une lettre purement étymologique, que l’on conserve comme une trace du mot radical où elle se trouvait, plutôt que comme le signe d’un élément réel du mot où elle est employée ; et, si elle commence le mot, la lettre finale du mot précédent, soit voyelle, soit consonne est réputée immédiatement suivie d’une voyelle.
Exemple : titre honorable se prononce titr’onorable parce que le « h » est muet donc il ne se prononce pas. (Jean-François Marmontel et Nicolas Beauzée, Encyclopédie méthodique, La lettre H, 1782-1786)
Distinguer les mots où le « h » est aspiré de ceux où il est muet ?
Il serait à souhaiter que l’on eût quelques règles générales pour distinguer les mots où l’on aspire la lettre « h » de ceux où elle est muette.
Vaugelas2 et Restaut3 pensent que, dans tous les mots qui commencent par un « h », et qui sont dérivés du grec ou du latin, le « h » ne s’aspire point, et que c’est précisément le contraire dans tous les mots dont l’origine est barbare ; mais, comme cette règle n’est rien qu’infaillible et générale ; comme d’ailleurs il doit paraître singulier qu’il faille étudier à fond le grec ou le latin, pour savoir comment il faut prononcer un mot de la langue française.
En tout cas, voici la règle exacte donnée par l’Académie française :
Le « h » n’a aucun son, et ne s’aspire point dans la plupart des mots qui viennent du latin et qui ont un « h » initial comme hablie, habitude, etc. Il faut excepter de cette règle plusieurs mots tels quehaleter, hennir, etc. Il n’a pareillement aucun son dans certains mots français qui ont un « h » initial, quoiqu’il n’y en ait pas dans le latin d’où ils viennent comme huile, huître, etc. Il s’aspire au commencement des autres mots français qui viennent des mots latins sans « h » comme hache, haut, etc., ainsi que dans tous les mots qui ne sont pas tirés du latin.
Mais ces règles sont, et difficiles à saisir, et sujettes à beaucoup d’exceptions. « Il est plus court, dit l’abbé d’Olivet4, et plus sûr de rapporter une liste des mots qui s’aspirent au commencement, au milieu, ou à la fin » (voir la liste ci-dessous).
Liste des mots les plus usités dans lesquels le « h » est aspiré
| Ha ! Hâbler (et ses dérivés) Hache Hacher Hachette Hachis Hachisch, hachich, hashich Hachoir Hachure Hagard Haie Haillon Haine (et ses dérivés) Haïr Haire Halage Halbran Halbrener Hâle (et ses dérivés) Halener Haletant, haleter Haleur Hall Hallage Hallali Halle Hallebarde Hallier Halo Hâloir Halot Halotechnie Halte Hamadryade Hameau Hampe Han Hanche Hand-ball Handicap, handicaper Hangar Hanneton Hanse Hanter Hantise | Happe Happe-lourde Happer Haquenée Haquet Haquetier Hara-kiri Harangue (et ses dérivés) Haras Harasser Harceler Harde Harder (se) Hardes Hardi (et ses dérivés) Harem Hareng Harengère Harengerie Hargneux, se hargner Haricot Haridelle Harnachement Harnacher Harnais, harnois Haro Harpagon Harpe (et ses dérivés) Harpeau Harper Harpie Harpon Harponner Harponneur Hart Hasard (et ses dérivés) Hase Hâte (et ses dérivés) Hâtereau Hâtier Hâtille Hâtive Hauban Haubaner Haubert | Hausse (et ses dérivés) Hausse-col Haut (et ses dérivés) hautain (et ses dérivés) Hautbois Haut-de-chausse(s) Haute-contre Haute-cour Haute-futaie Haut-fond Haut fourneau Haut-la-main Haut-le-cœur Haut-le-corps Haute lice Haut mal Haute paye Haut-parleur Hautesse Hauturier, hauturière Hâve Havane Havir Havre Havre-sac (ou havresac) Hé ! Heaume Héler Hem ! Hennir Hennissement Henri Henriade Héraut Hère Hérisser Hérisson Herniaire Hernie Hernieux Héron Héros Herse (et ses dérivés) Hêtraie Hêtre |
| Heurter (et ses dérivés) Heurtoir Hi, hi ! Hibou Hic Hideur Hideusement Hideux Hiérarchie (et ses dérivés) Hie High-life Hile Hisser Ho ! Hobereau Hoc Hoche Hochement (et ses dérivés) Hochepot Hochequeue Hocher Hochet Holà ! Hold-up Hollandais Hollande Homard Hongre Hongrois Honte (et ses dérivés) Hoquet Hoqueton Horde Horion Hors Hors-bord Hors-d’œuvre Hors-jeu Hors-la-loi Hors-série Hotte Hottée Hottentot Houblon (et ses dérivés) Houe | Houille (et ses dérivés) Houle Houlette Houleux Houppe Houppelande Hourdage Hourder Houri Hourra Hourvari Houseaux Houspiller Houssage Houssaie Housse (et ses dérivés) Houssine Houssoir Houx Hoyau Hublot Huche Hue ! Huée (et ses dérivés) Huguenot Huhau Huit (et ses dérivés) Hulotte Humer Hune Hunier Huppe Hure Hurlement Hurler Hurluberlu Hussard Hutte Hutter (se) Hyacinthe Hyalin |
Observations et remarques
● Le « h » conserve l’aspiration dans tous les mots qui sont composés de ceux nomenclaturés ci-dessus, tels que déharnacher, enhardi et ses dérivés, enharnacher, aheurtement, etc. Cette lettre fait alors l’effet du tréma, et sert à annoncer que la voyelle qui la suit ne s’unit pas en diphtongue à la voyelle qui la précède. On en excepte exhausser, exhaussement, qui sont sans aspiration, quoique formés de hausser, haussement, où le « h » est aspiré. (l’Académie française, Restaut3, Wailly5, Domergue6)
On ne doit excepter aussi que les dérivés de héros, qui sont tous sans aspiration. Ce sont : héroïde, héroïne, héroïque, héroïquement, héroïsme.
● La lettre « h » est ordinairement aspirée lorsqu’elle se trouve au milieu d’un mot entre deux voyelles comme dans cohue, aheurter, ahan. (Le Dictionnaire de l’Académie française)
● À la fin des mots, il n’y a aspiration que dans ces trois interjections : ah ! eh ! oh !
● « H » ne change rien à la prononciation du « t ».
● La lettre « h » est presque toujours aspirée dans les noms de pays et de villes : le Hainaut, la Hongrie, la Hollande, Hambourg, etc. Cependant le « h » n’est point aspiré dans les phrases suivantes : toile d’Hollande, fromage d’Hollande, eau de la reine d’Hongrie, où un usage fréquent a effacé l’aspiration. (Restaut3, Wailly5, Chapsal7, Gattel8 et Catineau9)
Toutefois, comme le dit Jean-Charles Nodier10, cet usage est celui des blanchisseuses et de l’office, et il ne devrait pas faire loi au salon.
● Onze, oui, quoique ne commençant point par un « h », se prononcent avec aspiration : de onze enfants qu’ils étaient, il n’en est resté que six ; de vingt, il n’en est resté que onze – le oui et le non. (l’Académie française)
● Dumarsais11 croit que si l’on écrit et l’on prononce le onze, c’est pour ne pas confondre l’onze avec l’once ; que si l’ « e » ne s’élide pas devant le oui, c’est pour éviter l’équivoque de l’ouïe et de Louis, et aussi pour mettre une symétrie entre le non et le oui.
● L’« o » n’est pas toujours aspiré dans onzième ; on dit le onzième et l’onzième. l’Académie française, Féraud12, Gattel8, Wailly5, et les écrivains ont formellement admis les deux prononciations. Vaugelas2 condamne le onzième. Aujourd’hui, on dit plus souvent le onzième que l’onzième.
● Les consonnes après lesquelles on emploie la lettre « h » sont c, l, p, r, t.
● On aspire Henri dans le discours soutenu, mais on ne peut pas l’aspirer dans la conversation.
● Bien des personnes n’aspirent pas le « h » dans huguenot, mais c’est une faute ; l’Académie française y marque l’aspiration.
● Autrefois on prononçait hésiter avec aspiration. D’après l’usage actuel, il n’y a plus d’aspiration.
● Quelques Grammairiens ne veulent point qu’il y ait une vraie aspiration dans huit ; mais c’est sans fondement, puisqu’on écrit et on prononce, sans élision1 ni liaison : le huit, les huit volumes, le ou la huitième, du ou de la huitième, à la huitième ; l’Académie française ne laisse aucun doute sur l’aspiration de ce mot et de ses dérivés. Cependant dix-huit, vingt-huit se prononcent di-zuit, vingt-huit.
🚀 Testez vos connaissances ! 🚀
Pouvez-vous maintenant distinguer entre les mots dans lesquels le « h » est aspiré de ceux dans lesquels le « h » est muet ? Pour le savoir, testez vos connaissances !
→ Exercice : « Le « h » aspiré et le « h » muet ».
Notes
1. L’élision : Elle consiste en l’effacement d’une voyelle en fin de mot devant la voyelle débutant le mot suivant. ▲
2. Claude Favre, seigneur de Vaugelas : Traducteur, linguiste et grammairien français (1585-1650) qui contribua par ses travaux à « régler » la langue. ▲
3. Pierre Restaut (1696-1764) est un grammairien français. Principes généraux et raisonnés de la Grammaire française (1730) fit sa réputation. Restaut revit la quatrième édition du Traité de l’orthographe française en forme de dictionnaire, connu sous le nom de Dictionnaire de Poitiers. ▲
4. Pierre-Joseph Thoulier d’Olivet, dit l’abbé d’Olivet, né à Salins le 1er avril 1682 et mort à Paris le 8 octobre 1768, est un homme d’Église, grammairien et traducteur français. Il édita les œuvres d’un certain nombre d’auteurs français. Il connut Boileau et compta Voltaire parmi ses élèves. Il collabora au Dictionnaire de l’Académie française. ▲
5. Noël-François De Wailly est un grammairien et lexicographe français né à Amiens le 31 juillet 1724 et mort à Paris le 7 avril (ou le 18 avril) 1801. Il publia les Principes généraux et particuliers de la langue française (1754) qui révolutionnèrent en France l’enseignement de la grammaire. Parmi ses ouvrages, on trouve L’Orthographe des dames(1782) et le Nouveau Vocabulaire français, ou abrégé du dictionnaire de l’Académie (1801). Il collabora activement au dictionnaire de l’Académie publié en 1798. ▲
6. François-Urbain Domergue, né à Aubagne le 24 mars 1745 et mort à Paris le 29 mai 1810, est un grammairien et journaliste français. Il est élu membre de l’Académie française en 1803 et participe à la commission du Dictionnaire de l’Académie. De ses ouvrages, on trouve Grammaire françoise simplifiée, ou Traité d’orthographe, avec des notes sur la prononciation et la syntaxe, des observations critiques et un nouvel essai de prosodie (1778), Grammaire générale analytique (1798-99), Exercices orthographiques, où les faits précèdent les règles (1810). ▲
7. Charles-Pierre Chapsal, né à Paris en 1787 et mort en 1858, est un grammairien français, ancien maire de Joinville-le-Pont. Son ouvrage principal est une Nouvelle Grammaire française avec Exercices, en collaboration avec François Noël, ouvrage plus complet et plus logique que la Grammaire de Charles François Lhomond, et qui eut un rapide et légitime succès. ▲
8. Claude-Marie Gattel, auteur du Dictionnaire universel de la langue française : avec prononciation figurée, Lugné et Cellard, 1827. ▲
9. Pierre-Marie-Sébastien Catineau-Laroche, né à Saint-Brieux le 25 mars 1772 et mort en 1828, fut imprimeur à Paris de 1799 à 1804, inspecteur des Douanes en Illyrie en 1810. Auteur du Nouveau dictionnaire de poche de la langue française, avec la prononciation, composée sur le système orthographique de Voltaire (1802). ▲
10. Charles Nodier, né Jean-Charles-Emmanuel Nodier à Besançon le 29 avril 1780 et mort le 27 janvier 1844 à Paris, est un académicien et écrivain romancier français à qui l’on attribue une grande importance dans la naissance du mouvement romantique. ▲
11. César Chesneau, sieur Dumarsais ou Du Marsais, né à Marseille le 17 juillet 1676 et mort à Paris le 11 juin 1756, est un grammairien et philosophe français. De ses ouvrages, on trouve Traité des Tropes (1730), Méthode raisonnée pour apprendre la langue latine (1722), Principes de grammaire (1769). ▲
12. Charles Nodier, né Jean-Charles-Emmanuel Nodier à Besançon le 29 avril 1780 et mort le 27 janvier 1844 à Paris, est un académicien et écrivain romancier français à qui l’on attribue une grande importance dans la naissance du mouvement romantique. ▲
Articles connexes
- L’Académie française.
- Autres rubriques : Grammaire. – Expression. – Conjugaison. – Vocabulaire. – Orthographe.
Suggestion de livres
 Le Grevisse de l’enseignant – 1000 exercices de grammaire Le Grevisse de l’enseignant – 1000 exercices de grammaire |  Le Bon usage Le Bon usage |
 Bescherelle – Le coffret de la langue française Bescherelle – Le coffret de la langue française |  Écrire sans fautes – Orthographe – Grammaire – Conjugaison Écrire sans fautes – Orthographe – Grammaire – Conjugaison |
[➕ Autres choix…]