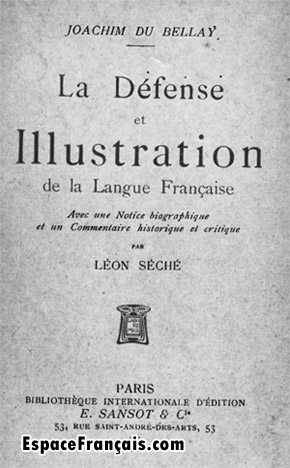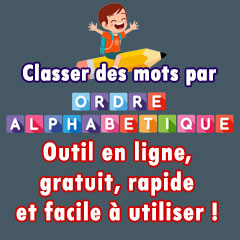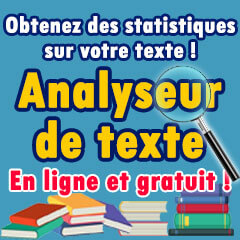Les Grands Rhétoriqueurs
Les courants littéraires ► vous êtes ici
Courants littéraires
La Grands Rhétoriqueurs
– milieu du XVe siècle, début du XVIe siècle –
Sommaire
Présentation
Les Grands Rhétoriqueurs (ou les Grands Rhéteurs) est un groupe de poètes bourguignons qui, à la fin du Moyen Âge, composent une poésie où dominaient procédés rhétoriques et souci de virtuosité. Le nom de grands rhétoriqueurs vient de la publication de plusieurs traités du XVe siècle sur la versification utilisant le terme de « rhétorique » dans leurs titres, comme dans les Arts de seconde rhétorique, la « seconde rhétorique » codifiant alors la poésie, ou la « rhétorique vulgaire » (c’est-à-dire « vernaculaire », par opposition à la rhétorique « latine »). Ces manuels poétiques suggéraient que la rime était une forme ou une branche de la rhétorique.
→ À lire : La rhétorique. – Les figures de rhétorique (niveau avancé). – Les figures de style (niveau scolaire).
→ À lire : Rhétorique et style.
Rhétoriqueurs de la cour de Bourgogne
Les poètes connus sous le nom de « grands rhétoriqueurs » étaient pour la plupart des poètes mondains, attachés à la cour de Bourgogne au XVe siècle, tels que Olivier de La Marche, Georges Chastellain ou Jean Molinet.
On doit à Chastellain (1404-1475), écuyer, chroniqueur et poète attaché à la personne de Philippe III le Bon, des œuvres de circonstances chantant les louanges de son protecteur, des poèmes courtois, mais aussi des traités politiques et une Chronique des choses de ce temps (posthume, 1863-1866) relatant avec une certaine clairvoyance les événements qui secouèrent la France entre 1419 et 1475.
Le poète Jean Molinet (1435-1507) devient, après Chastellain, le chroniqueur officiel de la cour de Bourgogne (Chroniques 1474-1506). Il compose sous le titre L’Art et science de rhétorique (1493) un art poétique qui rend bien compte du travail des rhétoriqueurs en cette matière. Sa poésie nous apparaît aujourd’hui comme une mise en pratique des théories formalistes qu’il y développe (Les Faicts et les Dicts de Jehan Molinet, posthume, 1531).
Rhétoriqueurs du royaume de France
Tous les rhétoriqueurs ne sont pourtant pas attachés à la cour de Bourgogne. On compte en effet parmi eux des poètes courtisans de France tels que Jean Marot (1450-1526), père de Clément Marot, qui est attaché à la cour d’Anne de Bretagne avant de devenir le protégé de François Ier. Pierre Gringoire (1475 ?-1538) est un poète prolifique sans originalité mais un homme de théâtre et un dramaturge habile, à qui l’on doit notamment des mystères (Vie de Monseigneur saint Louis, 1514) et des sotties (Le Jeu du prince des sots et de Mère sotte, 1511). Citons aussi le nom de Guillaume Crétin (1461-1525), historiographe de François Ier et auteur d’une œuvre poétique dominée par l’allégorie et l’emphase.
Héritier des rhétoriqueurs par son histoire personnelle (neveu de Jean Molinet, il est attaché à la cour de Bourgogne) et par l’usage qu’il fit de la rhétorique, le poète et humaniste Jean Lemaire de Belges marque pourtant une transition vers l’époque suivante et annonce davantage les auteurs de la Pléiade par son inspiration italienne et antique (en particulier par sa conception spirituelle et platonicienne de l’amour).
Poétique
La poésie des grands rhétoriqueurs, allégorique, hyperbolique et rhétorique, célébrant la gloire des hauts personnages, est représentative du raffinement de la vie seigneuriale de la fin du Moyen Âge. Cependant, par la surabondance même des procédés rhétoriques, par le souci presque exclusif de la belle forme, elle signale aussi, d’une certaine manière, la décadence de la poésie médiévale. Avec les rhétoriqueurs, la poésie s’apparentait à un simple jeu formel. Clément Marot, s’il est influencé par leur style, veut assujettir davantage les procédés stylistiques à la nécessité du discours et donner ainsi à la poésie une fonction expressive renouvelée. À ce titre, il est le premier poète de la Renaissance.
Déclin
Le déclin de la poésie des grands rhétoriqueurs s’explique par le renforcement de l’autorité royale à partir de Charles VII sur les grands féodaux qui entretenaient une cour, alors même que la veine réaliste est portée par l’urbanisation de la population due aux destructions de la Guerre de Cent Ans et les transferts de richesses provoqués par l’inflation et la spéculation. Cette veine trouve une expression annonciatrice de François Villon chez Pierre de Nesson, Michault Taillevent, Pierre Chastellain ou Jehan Regnier (thèmes de l’infortune, du temps qui passe et de la mort).
À la fin des années 1540, la Pléiade a considéré les grands rhétoriqueurs comme les représentants d’une tradition médiévale dépassée (tout particulièrement Joachim Du Bellay dans la Défense et illustration de la langue française). Cette prise de distance peut également avoir eu des motivations liées à l’esprit de classe et au renforcement du sentiment national : de nombreux poètes et écrivains grands rhétoriqueurs étaient des roturiers au service de la cour de Bourgogne, tandis que le cercle de Pierre de Ronsard était entièrement français et dominé par les nobles.
Quelques grands rhétoriqueurs
Sont considérés comme « grands rhétoriqueurs » :
- XIVe siècle
Guillaume de Machaut (vers 1300-1377), considéré comme le grand précurseur du mouvement. - XVe siècle
Jean Robertet (1405-1492), à la cour de Bourbon
Georges Chastelain (1415-1475), à la cour de Bourgogne
Henri Baude (1415-1490), à la cour de France
Jean Meschinot (1422-1490), à la cour de Bretagne
Olivier de la Marche (1425-1502), à la cour de Bourgogne
Jean Molinet (1435-1507), à la cour de Bourgogne
Octavien de Saint-Gelais (1468-1502) - XVIe siècle
Jean Marot (v. 1450-1526), à la cour de France
Guillaume Crétin (v. 1460-1525)
André de La Vigne (v. 1470-ap. 1515)
Jean Lemaire de Belges (1473-1515 ?), à la cour de Bourgogne, puis de France
Pierre Gringore (1475-1539)
Jean Bouchet (1476-1557)
Courants littéraires
| Introduction et sommaire | |
| XVe siècle | |
| XVIe siècle | |
| XVIIe siècle | |
| XVIIIe siècle | |
| XIXe siècle | |
| XXe siècle | |
Articles connexes
- Qu’est-ce qu’un courant/mouvement littéraire ?
- Genres littéraires » Le genre poétique. – La poésie : repères historiques.
- Auteurs du XVIe siècle.
- Histoire de la France : l’Ancien Régime.
- Histoire de la littérature française du XVIe siècle.
- Joachim Du Bellay : Défense et illustration de la langue française.
- La rhétorique. – Les figures de rhétorique (niveau avancé). – Les figures de style (niveau scolaire).
- Rhétorique et style.
Suggestion de livres
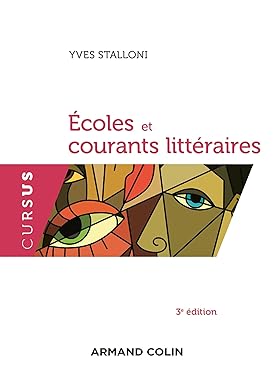 |  |
 |  |
[➕ Autres choix…]