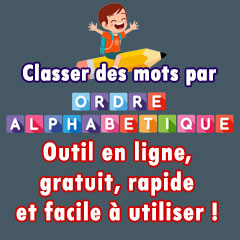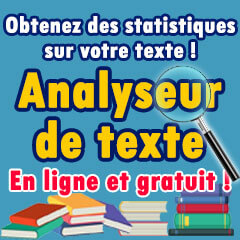Les Muses
Lumière sur… ► vous êtes ici
Lumière sur…
Les Muses
Sommaire
Introduction
Les Muses, dans la mythologie grecque, sont les neuf déesses de l’Inspiration poétique et musicale, de la Connaissance, et gardiennes de l’oracle de Delphes. Par métonymie, l’expression « les Muses » ou « la Muse » implique les belles-lettres, notamment la poésie, l’inspiration ou l’invention poétique. Parfois avec majuscule, la Muse est l’inspiration poétique, souvent imaginée par le poète sous l’apparence d’une femme. Enfin, la muse peut être, tout simplement, la source d’inspiration littéraire. C’est une femme inspiratrice d’un écrivain ou d’un poète. Ainsi, George Sand est la muse d’Alfred de Musset ; et Elvire, la muse d’Alphonse de Lamartine.
Dans le langage argotique, la Muse verte désigne l’absinthe : une liqueur alcoolique toxique, de couleur verte, extraite d’une des variétés (grande absinthe) de la plante portant le même nom. Émile Zola, Van Gogh, Paul Verlaine, Barbara et bien d’autres feront de l’absinthe, une boisson intemporelle, mystique et légendaire.

Raphaël, Le Parnasse : fresque réalisée de 1509 à 1511 pour le Palais du Vatican à Rome.
Légende
Inspiratrices des Arts poétiques
À l’origine, les Muses sont au nombre de trois et président ensemble à l’Inspiration poétique et à la musique. Ce n’est qu’à l’époque d’Hésiode que leur nombre est fixé à neuf et leurs attributions déterminées. Selon ce dernier, ces jeunes femmes nées des neuf nuits consécutives que Zeus a passées avec Mnémosyne, la Mémoire, sont : Calliope pour la Poésie épique, Clio pour l’Histoire, Euterpe pour la Poésie lyrique, Thalie pour la Comédie, Melpomène pour la Tragédie, Terpsichore pour le Chant choral et la Danse, Érato pour la Poésie amoureuse, Polymnie pour la Poésie sacrée et l’Hymne et Uranie pour l’Astronomie. Mais les Muses restent d’une façon générale la source d’inspiration des poètes :
Il y a un troisième genre de possession et de délire, celui dont les Muses sont le principe : si l’âme qui en est saisie est une âme délicate et immaculée, elle en reçoit l’éveil, il la plonge dans des transports qui s’expriment en odes, en poésies diverses, il pare de gloire mille et mille exploits des anciens, et ainsi, il fait l’éducation de la postérité.
(Platon, Phèdre)
Les Muses accompagnent souvent les Grâces et Apollon (dit alors Apollon Musagète), avec lequel plusieurs d’entre elles se sont unies, sur le mont Parnasse. Mais on les trouve aussi sur l’Olympe, assises à côté du trône de Zeus, louant sa grandeur, sa victoire sur les Titans, chantant les origines du monde et de ses habitants, ainsi que les exploits glorieux des autres dieux et des grands héros. Elles se rendent aussi sur le mont Hélicon, où les poètes et les musiciens viennent chercher l’inspiration. Là se trouvent des fontaines sacrées, en particulier l’Aganippé et l’Hippocrène (fontaine jaillie sous le sabot du cheval ailé Pégase), dont les eaux apportent l’inspiration à ceux qui les boivent. La fontaine Castalie du mont Parnasse possède les mêmes propriétés. Hésiode, dans Théogonie, parle ainsi des déesses :
Pour commencer, chantons les Muses Héliconiennes, reines de l’Hélicon, la grande et divine montagne. Souvent, autour de la source aux eaux sombres et de l’autel du très puissant fils de Cronos, elles dansent de leurs pieds délicats. Souvent aussi, après avoir lavé leur tendre corps à l’eau du Parnasse ou de l’Hippocrène ou de l’Olmée divin, elles ont, au sommet de l’Hélicon, formé des chœurs, beaux et charmants, où ont voltigé leurs pas ; puis, elles s’éloignaient, vêtues d’épaisse brume, et, en cheminant dans la nuit, elles faisaient entendre un merveilleux concert, célébrant Zeus qui tient l’égide, et l’auguste Héra d’Argos, chaussée de brodequins d’or […] et toute la race sacrée des Immortels toujours vivants !
Annonce
Les Muses sont également dotées du don de divination, tout comme Apollon qui conduit leur cortège. Ce sont elles qui enseignent cet art à Aristée, fils d’Apollon et de la nymphe Cyrène.
Un caractère ombrageux
Les Muses punissent sans pitié quiconque essaie de rivaliser avec elle ou a la présomption de vouloir les surpasser. Ainsi le poète Thamyris, célèbre pour ses créations vocales, fait les frais de leur susceptibilité. Apollon, jaloux de l’affection que ce dernier porte à Hyacinthe, dit aux Muses que le poète se vante de les surpasser dans l’art du chant. Pour le punir, les déesses lui ôtent la voix en même temps que la vue.
Une autre légende dit que les neuf Piérides, filles du roi de Macédoine Piéros, ont un jour l’imprudence de se vanter de leur talent, et d’affronter les Muses dans un concours poétique. Battues par les déesses, elles sont changées en pies par Apollon.
On raconte aussi que les Sirènes, ayant défié les Muses dans le domaine du chant, ont gardé leur voix envoûtante mais ont perdu leurs ailes.
Les amours des Muses
Passant à l’origine pour des vierges farouches, les Muses deviennent par la suite des jeunes femmes avenantes auxquelles on connaît diverses liaisons avec des dieux et des mortels. Calliope, unie à Apollon, donne le jour à Hymenoeos, Ialemos et Orphée, musicien de génie ne connaissant aucun rival parmi les mortels (Orphée passe aussi pour le fils de Calliope et d’Œagre). De l’union de Calliope et d’Apollon a également pu naître Linos, inventeur de la mélodie et du rythme, que l’on donne parfois pour le fils d’Uranie et du musicien Amphimaros ou encore de Terpsichore et d’Apollon. Ce dernier a également partagé la couche de Thalie, donnant naissance aux Corybantes. Certains récits font des Sirènes les filles de Melpomène ou de Terpsichore et du dieu-fleuve Acheloos, bien que ces dernières soient aussi considérées comme les filles du dieu marin Phorcys. L’une des Muses (Calliope, Euterpe ou Terpsichore selon les récits) conçoit avec le dieu-fleuve Strymon un garçon, Rhésos. Clio, quant à elle, à la suite d’une passion amoureuse pour le roi Piéros inspirée par Aphrodite, donne le jour à Hyacinthe, un jeune homme qui sera aimé d’Apollon et en connaîtra une fin tragique.
Culte
Le culte des Muses est originaire de Piérie, sur les pentes du mont Olympe. Il s’est ensuite répandu en Boétie, en particulier autour du mont Hélicon, puis dans toute la Grèce antique. Dans la ville de Thespies, des fêtes sont organisées tous les cinq ans en l’honneur des déesses. Elles sont notamment marquées par des concours où s’affrontent les poètes. Les Muses reçoivent également des offrandes à base de lait et de miel.
Représentation et références musicales
Si les Muses sont dans la mythologie la source d’inspiration des poètes, leurs personnages ont été un sujet de prédilection pour nombre de sculpteurs, peintres, poètes et compositeurs, de l’Antiquité jusqu’à nos jours.
On rencontre les Muses chez de nombreux auteurs grecs, dont Hésiode (Théogonie), Homère (Hymnes homériques), Plutarque (Propos de table) ou encore Lucien de Samosate (Portraits). Dans l’Antiquité grecque comme romaine, les Muses ont également inspiré de nombreuses peintures et statues. Citons par exemple Trois muses : Uranie, Calliope, Melpomène, un vase grec à figures rouges (vers 455-440 av. J.-C., musée du Louvre, Paris) ou Le Sarcophage des Muses, un marbre romain (vers 160 av. J.-C., musée du Louvre).
Avec le regain d’intérêt pour l’art antique qui se développe à partir de la Renaissance, les œuvres picturales représentant les Muses, seules ou accompagnées d’autres personnages mythologiques, sont légion. Ainsi, la fresque de Raphaël Parnasse (1510-1511), au Vatican, met en scène les Muses et de grands poètes autour d’Apollon. Le Parnasse d’Andrea Mantegna (1496, musée du Louvre) représente de même les Muses dansant autour du dieu de la Musique. À la même période, Baldassare Peruzzi peint une Ronde des Muses. Au XVIIe siècle, on retrouve Apollon entouré de deux Muses dans Uranie et Calliope de Simon Vouet (vers 1634, National Gallery of Art, Washington), tandis qu’Eustache Le Sueur peint le cabinet des Muses de l’hôtel Lambert (Paris) et que Romanelli orne l’un des plafonds du Louvre d’un Apollon et les Muses. Nicolas Poussin, s’inspirant du Parnasse de Raphaël, réalise vers 1630 l’Inspiration du poète (musée du Louvre). Plus tard, Ingres et Gustave Moreau s’intéresseront eux aussi aux déesses de l’Inspiration artistique, le premier mettant en scène Le Compositeur Cherubini et la Muse de la poésie lyrique (1842, musée du Louvre) et La Naissance des Muses (1856, musée du Louvre), le second réalisant une série d’études et de dessins tels que Apollon pleuré par les Muses et Apollon et les neuf Muses (respectivement 1856 et vers 1868, musée Gustave Moreau, Paris).
Les Muses apparaissent aussi dans quelques œuvres musicales, dont Les Muses de Pierre Beauchamp (1666) et le ballet Apollon Musagète de Georges Balanchine (1928).
Articles connexes
- Le mythe : définition et fonctions.
- L’hymne. – Les Hymnes homériques.
- Genres littéraires » La poésie.
- La poésie : repères historiques.
- Lumière sur…
- Exercice : Les dieux et les déesses de la mythologie grecque et romaine.
Suggestion de livres
 La mythologie : Ses dieux, ses héros, ses légendes |  Les héros de la mythologie |  Grand dictionnaire de la mythologie grecque et romaine |  Les plus beaux récits de la mythologie grecque |