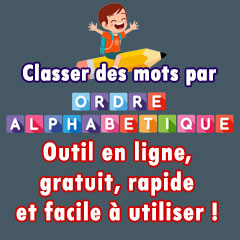Maguerite Duras : Un barrage contre le Pacifique (1950)
L’univers des livres ► XXe siècle ► Marguerite Duras ► vous êtes ici
Marguerite Duras
Un barrage contre le Pacifique (1950)
Sommaire
👤 Marguerite Duras, née le 4 avril 1914 à Gia Định près de Saïgon, alors en Indochine française, et morte le 3 mars 1996 à Paris, est une écrivaine, dramaturge et cinéaste française. Elle est l’une des figures les plus importantes de la littérature française du XXe siècle. [Lire la suite de sa biographie]
Présentation
 Un barrage contre le Pacifique est un roman de Marguerite Duras, publié en 1950.
Un barrage contre le Pacifique est un roman de Marguerite Duras, publié en 1950.
Troisième roman de Marguerite Duras, Un barrage contre le Pacifique s’inscrit dans le climat de malaise laissé par la guerre d’Indochine, et se lit comme le reflet décalé et prémonitoire — le récit se situe dans les années 1925 — du drame social que fut la colonisation.
Basé sur l’expérience personnelle de l’auteure en Indochine française, le livre raconte l’histoire d’une veuve française, Madame D, et de ses deux enfants, Joseph et Suzanne, qui luttent pour survivre dans une région isolée et hostile de l’Indochine. Face à des conditions de vie difficiles et à la corruption des autorités coloniales, Madame D investit dans la construction d’un barrage pour protéger sa propriété des inondations, malgré les obstacles et les désillusions.
Le roman explore les thèmes de la lutte contre l’adversité, de la résilience et de la désillusion face aux promesses de progrès.
L’écriture de Marguerite Duras dans Un barrage contre le Pacifique est caractérisée par sa concision et sa puissance évocatrice, capturant à la fois la beauté et la brutalité de la colonisation.
🛒 Acheter Un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras.
→ À lire aussi de Marguerite Duras : Moderato cantabile (1958). – Hiroshima mon amour (1960). – Le Ravissement de Lol V. Stein (1964). – India Song (1973). – L’Amant (1984).
Une « mère courage » aux colonies
Dans une tonalité partagée entre rires et désespoirs, le roman retrace, dans un temps figé, les quelques semaines qui séparent une femme colon de la mort qu’elle attend comme une dignité. Vouée à la misère, elle est en effet acculée par la mer qui détruit à chaque marée le barrage protégeant la concession infertile que le cadastre lui a vendue. C’est à une lente désagrégation des éléments qui les relient au monde, elle et ses enfants, que le lecteur assiste à travers deux parties qui s’organisent selon une dialectique de l’espoir — incarné par la fuite du clan vers le dehors — et de la désillusion — l’inévitable revers du désir de possession. Dans une parabole existentialiste qui condense la vie entière du personnage, le barrage devient ainsi le symbole de la tentative humaine de maîtriser la force fatale de l’échec et de la destruction.
Le roman familial
Si témoignage il y a sur le colonialisme, ses spéculations et ses oppressions — et Marguerite Duras ne dément pas la part du biographique dans le roman —, il ne constitue que la toile de fond de la représentation romancée d’un malheur familial, qui ouvre ce que Duras appellera « le roman de la mère », série de textes liés à cette enfance indochinoise qu’elle ne cessera de réécrire, comme autant de fables à l’origine d’une réalité intime dévastée.
Extrait : Un barrage contre le Pacifique
Un barrage contre le Pacifique est le premier roman qui soit lié à l’enfance indochinoise de l’auteur et au déploiement fantasmatique auquel elle ne cessera de la soumettre tout au long de son œuvre. La déformation du réel et de l’infortune familiale à des fins mythiques passe par le grossissement des événements et des personnages. La mère, figure centrale et modèle de déveine, y apparaît comme un monstre aussi puissant que naïf, à l’image des crabes rongeant inlassablement les digues du barrage qui entourent la concession qu’elle possède sur le Pacifique.
La mère tenta de sourire.
— Moi, je crois que ça a de l’importance. Je me suis toujours demandé pourquoi il en faisait tant. Suzanne en fait moins que lui.
— S’il en a besoin il l’apprendra, vous vous en faites tout le temps. Moi je compte que je l’apprendrai l’orthographe, faudra bien.
Pour la première fois depuis des mois, Suzanne regardait la mère avec attention. Elle donnait l’impression de s’être enfin résignée à toutes ses défaites mais sans être tout à fait parvenue à maîtriser sa vieille violence. Cependant avec le fils Agosti elle s’efforçait d’être aimable et conciliante.
— Quelquefois, dit la mère, je me dis que même s’il le voulait, Joseph aurait beaucoup de mal à l’apprendre. Il n’est pas fait pour ce genre de choses, ça l’ennuie tellement que jamais il n’y arrivera.
— Faut que tu t’en fasses toujours pour quelque chose, dit Suzanne, maintenant c’est parce que Joseph fait des fautes d’orthographe, faut toujours que tu inventes quelque chose.
La mère hocha la tête en signe d’approbation. Même sur elle-même, elle n’avait plus rien à apprendre. Elle réfléchit à ce qu’elle allait dire, indifférente tout à coup à leur présence.
— On m’aurait dit ça, dit-elle enfin, quand ils étaient petits, on m’aurait dit qu’à vingt ans ils feraient encore des fautes d’orthographe, j’aurais préféré qu’ils meurent. J’étais comme ça quand j’étais jeune, j’étais terrible.
Elle ne les regardait plus ni l’un ni l’autre.
— Puis ensuite bien sûr, j’ai changé. Puis voilà maintenant que ça me revient comme quand j’étais jeune, il me semble quelquefois que je préférerais voir Joseph mort que de le voir faire tellement de fautes d’orthographe.
— Il est intelligent, dit Suzanne, quand il le voudra il apprendra l’orthographe. Suffit qu’il veuille.
La mère fit un geste de dénégation ;
— Non, maintenant il ne l’apprendra plus. Maintenant personne ne s’en chargera, faut que j’y aille. Il n’y a que moi qui puisse le faire. Tu dis qu’il est intelligent, moi je dis que je ne sais pas s’il l’est. Maintenant qu’il est parti et que je repense à ces choses, je me dis que peut-être il ne l’est pas.
La colère perçait dans ses paroles, toujours aussi forte, plus forte qu’elle. Elle paraissait épuisée et transpirait beaucoup en parlant. Elle devait lutter contre la torpeur, de toute sa colère. C’était la seule conversation qu’elle soutenait depuis qu’elle prenait la double dose de pilules.
— Y a pas que l’orthographe, dit Agosti, qui peut-être se sentait visé par la mère ou peut-être cherchait à la calmer.
— Il y a quoi ? il n’y a rien de plus important, si tu ne sais pas écrire une lettre tu ne peux rien faire, c’est comme s’il te manquait, je ne sais pas moi, un bras par exemple.
— À quoi ça t’a servi d’écrire tant de lettres au cadastre ? demanda Suzanne, ça t’a servi à rien du tout. Quand Joseph a tiré un coup de chevrotines en l’air, ça a fait plus d’effet au type que toutes tes lettres.
Elle n’était pas convaincue. Et plus la conversation sur l’orthographe durait, plus elle se désespérait de ne pas arriver à trouver l’argument qui pourrait les convaincre.
— Vous ne pouvez pas comprendre. Tout le monde peut tirer des coups de chevrotines en l’air, mais pour se défendre contre les salauds, il faut autre chose. Quand vous l’aurez compris, ce sera trop tard. Joseph se fera rouler par tous ces salauds et quand je pense à ça c’est pire que s’il était mort.
— Faut quoi pour se défendre ? dit Jean Agosti, qu’est-ce qu’il faudrait faire contre les agents de Kam ?
La mère frappa le lit avec ses mains qui sortaient du drap.
— Je ne le sais pas moi, mais il y a certainement quelque chose à faire et ça arrivera tôt ou tard. Ceux qui sont là, on pourrait toujours les descendre. Il n’y a que ça qui pourrait me faire du bien. Rien d’autre, peut-être même plus Joseph. Pour voir ça je pourrais me lever.
Elle attendit un peu, puis elle se dressa sur son lit, les yeux grands ouverts et brillants.
— Tu le sais, tu le sais que j’ai travaillé pendant quinze ans pour pouvoir acheter cette concession. Pendant quinze ans, je n’ai pensé qu’à ça. J’aurais pu me remarier, mais je ne l’ai pas fait pour ne pas me distraire de la concession que je leur donnerais. Et tu vois où j’en suis maintenant ? Je voudrais que tu le voies bien et que tu ne l’oublies jamais.
Elle ferma les yeux, et, épuisée, s’affaissa sur son oreiller. Elle portait une vieille chemise de son mari. Autour de son cou, il n’y avait plus le diamant mais seulement la clef de la remise attachée à la ficelle. Ça n’avait plus de sens parce que maintenant elle se serait laissé voler avec indifférence.
— Je crois que Joseph a eu raison, j’en suis de plus en plus sûre. Et si je reste au lit c’est pas à cause de Joseph ou parce que je suis malade, c’est autre chose.
— À cause de quoi ? demanda Suzanne, à cause de quoi ? faut le dire.
La figure de la mère se rida. Peut-être qu’elle allait se mettre à pleurer devant Agosti.
— Je ne sais pas, dit-elle d’une voix enfantine, je me trouve bien au lit.
Elle faisait un effort visible pour retenir ses larmes devant Agosti.
— Je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus si je me levais. Moi, je peux plus rien pour personne.
Tout en parlant elle levait les mains et les laissait retomber sur le lit dans un geste d’impuissance et d’exaspération.
— Dans le haut, dit doucement Suzanne, après un moment, ils ont fait des ananas. Et ça se vend bien. Faudrait peut-être voir.
La mère renversa la tête en arrière et ses larmes commencèrent à couler malgré elle. Le fils Agosti eut un mouvement vers elle comme pour l’empêcher de tomber.
— C’est du terrain sec, chez eux, dit-elle en pleurant, ici on ne peut pas en faire.
Par quelque côté qu’on la prenne maintenant on l’atteignait toujours dans des régions vives et douloureuses. Ce n’était plus possible de lui parler de quoi que ce soit. Toutes ses défaites se tenaient en un réseau inextricable et elles dépendaient si étroitement les unes des autres qu’on ne pouvait toucher à aucune d’elles sans entraîner toutes les autres et la désespérer.
— Et puis pourquoi est-ce que je ferais des ananas ? pour qui ?
Le fils Agosti se leva, vint plus près d’elle et resta debout à la hauteur de sa tête pendant un long moment. Elle se taisait.
— Faut que je parte, dit-il. Voilà l’argent du diam.
Elle se redressa d’un seul coup et rougit violemment. Jean Agosti prit dans sa poche une liasse épinglée de billets de mille et la lui tendit. Elle les prit machinalement et les garda dans sa main entrouverte, sans les regarder, sans le remercier.
— Il faut m’excuser, dit-elle alors avec douceur. Mais tout ce qu’on me dit je le sais. J’avais pensé aux ananas, je sais que l’usine de Kam les achète très cher pour faire des jus de fruits. Tout ce qu’on peut me dire je le sais.
— Faut que je parte, répéta Agosti.
— Au revoir, dit la mère. Peut-être que tu reviendras ?
Il fit une grimace. Sans doute tout à coup, découvrait-il ce qu’on voulait peut-être de lui, ce qu’on aurait voulu qu’il dise, les assurances même très vagues qu’on attendait.
— Je ne sais pas, oui peut-être.
La mère lui tendit la main sans répondre, sans le remercier. […]
(Marguerite Duras, Un barrage contre le Pacifique, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1978)
Articles connexes
- Auteurs du XXe siècle.
- Biographie de Marguerite Duras.
- Œuvres de Marguerite Duras : Moderato cantabile (1958). – Hiroshima mon amour (1960). – Le Ravissement de Lol V. Stein (1964). – India Song (1973). – L’Amant (1984).
- Histoire de la France : le XXe siècle.
- La littérature française du XXe siècle.
- Littérature et engagement au XXe siècle.
- Le Nouveau Roman (XXe siècle).
- Genres littéraires.
Suggestion de livres
 |  |  |
 |  |  |
[➕ Autres choix…]