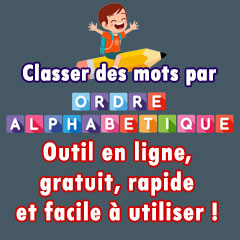Étienne de La Boétie
Auteurs français ► XVIe siècle ► vous êtes ici
Auteurs français
Étienne de La Boétie
1530 – 1563
Sommaire
- Présentation
- « Parce ce que c’était lui, parce que c’était moi »
- Une œuvre peu abondante
- « Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux »
- On parle de La Boétie…
- Extrait : Discours de la servitude volontaire d’Étienne de La Boétie
- Extrait : Mémoire sur la pacification des troubles d’Étienne de La Boétie
- 📽 15 citations choisies d’Étienne de La Boétie
- Œuvres
Présentation
Étienne de La Boétie, né le 1er novembre 1530 à Sarlat et mort le 18 août 1563 à Germignan, est un écrivain français, ami de Montaigne et auteur d’un essai célèbre Discours de la servitude volontaire (1576). Il a rédigé également de nombreux sonnets.
→ À lire : La Boétie : Discours de la servitude volontaire (1576).
« Parce ce que c’était lui, parce que c’était moi »

Portrait d’Étienne de La Boétie. Harlingue/Roger-Viollet/Getty Images
Né à Sarlat (Dordogne), Étienne de La Boétie est issu de la noblesse de robe périgourdine. Il fait des études de droit à Orléans, avant d’être nommé conseiller du parlement de Bordeaux en 1553. Il y rencontre Michel de Montaigne en 1558, et leur amitié très forte dure jusqu’à la mort prématurée de La Boétie. C’est en sa mémoire que Montaigne commence la rédaction de ses Essais. Il lui consacre le chapitre le plus émouvant de cette œuvre, « De l’amitié », où il définit, avec des mots simples, l’amour qu’il lui porte et sa tristesse de l’avoir perdu si tôt : « Nous étions à moitié de tout ; il me semble que je lui dérobe sa part. » La pensée de La Boétie et son attitude face à la mort ont d’ailleurs largement influencé la vie et l’œuvre de son ami. Elles lui ont notamment inspiré ses idées sur le stoïcisme.
→ À lire : Biographie de Montaigne. – Lumière sur les Essais (1580) de Montaigne.
Une œuvre peu abondante
La Boétie laisse derrière lui une production littéraire réduite. De son œuvre, sans doute commencée vers 1553, il reste des traductions de Xénophon et de Plutarque, ainsi que quelques poèmes en latin ou en français, tels les Vingt-Neuf Sonnets, poésies apparentées à celles de La Pléiade et citées dans les Essais de Montaigne. Il est également l’auteur d’un Mémoire sur la pacification des troubles, écrit en 1562, où il exprime sa crainte que la confrontation des religions catholique et protestante ne vienne rompre l’unité de la France.
« Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux »
L’ouvrage le plus marquant d’Étienne de La Boétie reste un court essai, le Discours de la servitude volontaire, aussi appelé Contr’un, écrit dès 1548 mais publié en 1576. L’écrivain y analyse les rapports entre le maître et l’esclave et tente de comprendre comment le peuple peut se placer volontairement sous la domination d’un tyran. Selon lui, l’oppressé doit exercer son droit naturel à la liberté : « Soyez résolus de ne servir plus, et vous voilà libres. » S’il ne dit pas comment atteindre cette liberté, La Boétie, pacifiste convaincu, fondamentalement optimiste et humaniste, pense que l’amitié, la « mutuelle estime », l’honnêteté et surtout l’exercice de la raison sont des moyens de s’en approcher.
Ce texte a suscité des interprétations contradictoires : Montaigne et d’autres y ont vu la simple dissertation d’un jeune homme constatant qu’un peuple doit accepter de s’asservir lui-même avant de confier le pouvoir à un seul homme. Beaucoup l’ont considéré comme un pamphlet contre la tyrannie, voire contre la monarchie. C’est cette seconde interprétation qui a assuré la notoriété de l’ouvrage, réimprimé à chaque période de lutte politique intense. Montaigne, à qui La Boétie a légué ses écrits, a refusé de publier cette œuvre, redoutant que les propos de son ami ne soient utilisés pour légitimer des mouvements de révolte. Imprimé par les protestants après le massacre de la Saint-Barthélemy, cet essai, auquel Jean-Paul Marat et Félicité Robert de Lamennais se sont référés, a par la suite servi les causes républicaines, socialistes et libertaires.
On parle de La Boétie…

Montaigne, Lettre à son père sur la mort d’Étienne de La Boétie, Le Promeneur, 2012, 104 p.
On ne sait que bien peu de chose de La Boétie. La lettre touchante écrite par Montaigne à son père sur la mort de son ami fait assez voir la hauteur de son âme :
Mon frère, me dit-il, tenez-vous auprès de moi, s’il vous plaît. Et puis, […] il prit une voix plus éclatante et plus forte, et donnait des tours dans son lit avec tout plein de violence […] Lors entre autres choses, il se prit à me prier et reprier avec une extrême affection, de lui donner une place: de sorte que j’eus peur que son jugement fut ébranlé. Même que lui ayant bien doucement remontré, qu’il se laissait emporter au mal, et que ces mots n’étaient pas d’homme bien rassis, il ne se rendit point au premier coup, et redoubla encore plus fort : Mon frère, mon frère, me refusez-vous donc une place ? Jusques à qu’il me contraignît de le convaincre par raison, et de lui dire, que puisqu’il respirait et parlait, et qu’il avait corps, il avait par conséquent son lieu – Voire, voire, me répondit-il lors, j’en ai, mais ce n’est pas celui qu’il me faut ; et puis, quand tout est dit, je n’ai plus d’être. Dieu vous en donnera un meilleur bientôt, lui fis-je. Y fusse-je déjà, mon frère, me répondit-il, il y a trois jours que j’ahanne pour partir.
Annonce
(Montaigne, Sur la Mort d’un ami, Texte présenté par France Quéré, Paris, Desclée De Brouwer, « Les Carnets DDB », 1995, p. 62-64)
Jacques Auguste de Thou👤 en dit aussi quelques mots dans son Histoire universelle depuis 1543 jusqu’en 1607 :
Étienne de La Boétie, dit-il, à peine âgé de trente-trois ans, conseiller au parlement de Bordeaux, mourut à Sarlat en Périgord, lieu de sa naissance. Il avait un esprit admirable, une érudition vaste et profonde, et une facilité merveilleuse à parler et à écrire ; il s’appliqua surtout à la morale et à la politique. Doué d’une prudence rare et au-dessus de son âge, il aurait été capable des plus grandes affaires s’il n’eût pas vécu éloigné de la cour, et si une mort prématurée n’eût pas empêché le public de recueillir les fruits d’un si sublime génie. Nous sommes redevables à Michel de Montaigne, son estimable ami, de ce qu’il n’est pas entièrement mort ; il a recueilli et publié plusieurs de ses ouvrages qui font voir la délicatesse, l’élégance et l’étonnante sublimité de ce jeune auteur. Je ne puis omettre son discours sur la Servitude volontaire dont j’ai déjà fait l’éloge, et qui fut pris par ceux qui le publièrent en un sens tout-à-fait contraire à celui que son sage et son savant auteur avait en le composant.
(Jacques Auguste de Thou, Histoire universelle depuis 1543 jusqu’en 1607, chap. LXXXV, 1734)
👤 Jacques Auguste de Thou
Jacques Auguste de Thou, né le 8 octobre 1553 à Paris, où il est mort le 7 mai 1617, est un magistrat, historien, écrivain et homme politique français. Latiniste éminent, il publie plusieurs ouvrages de poèmes latins, notamment à Tours, chez Jamet Mettayer mais sa célébrité lui vient de ses Historiae sui temporis, histoire de son temps portant sur les années 1543 à 1607, qui sera traduite du latin en français en 1659.
Extrait : Discours de la servitude volontaire d’Étienne de La Boétie
Œuvre de jeunesse, empreint de métaphysique antique et de morale stoïcienne, le Discours de la servitude volontaire rend compte des réflexions et des jugements que l’humaniste Étienne de La Boétie porte sur les rapports que l’homme de la Renaissance entretient avec la liberté et ceux qu’il tisse avec le pouvoir.
[…] Les lourdauds ne s’apercevaient pas qu’en recevant toutes ces choses, ils ne faisaient que recouvrer une part de leur propre bien ; et que cette portion même qu’ils en recouvraient, le tyran n’aurait pu la leur donner, si, auparavant, il ne l’eût enlevée à eux-mêmes. Tel ramassait aujourd’hui le sesterce, tel se gorgeait, au festin public, en bénissant et Tibère et Néron de leur libéralité qui, le lendemain, étant contraint d’abandonner ses biens à l’avarice, ses enfants à la luxure, son rang même à la cruauté de ces magnifiques empereurs, ne disait mot, pas plus qu’une pierre et ne se remuait pas plus qu’une souche. Le peuple ignorant et abruti a toujours été de même. Il est, au plaisir qu’il ne peut honnêtement recevoir, tout dispos et dissolu ; au tort et à la douleur qu’il ne peut raisonnablement supporter, tout à fait insensible. Je ne vois personne maintenant qui, entendant parler seulement de Néron, ne tremble au seul nom de cet exécrable monstre, de cette vilaine et sale bête féroce, et cependant, il faut le dire, après sa mort, aussi dégoûtante que sa vie, ce fameux peuple romain en éprouva tant de déplaisir (se rappelant ses jeux et ses festins) qu’il fut sur le point d’en porter le deuil. Ainsi du moins nous l’assure Cornelius Tacite, excellent auteur, historien des plus véridiques et qui mérite toute croyance. Et l’on ne trouvera point cela étrange, si l’on considère ce que ce même peuple avait fait à la mort de Jules César, qui foula aux pieds toutes les lois et asservit la liberté romaine. Ce qu’on exaltait surtout (ce me semble) dans ce personnage, c’était son humanité, qui, quoiqu’on l’ait tant prônée fut plus funeste à son pays que la plus grande cruauté du plus sauvage tyran qui ait jamais vécu ; parce qu’en effet ce fut cette fausse bonté, cette douceur empoisonnée qui emmiella le breuvage de la servitude pour le peuple romain. Aussi après sa mort ce peuple-là qui avait encore en la bouche le goût de ses banquets et à l’esprit la souvenance de ses prodigalités, amoncela les bancs de la place publique pour lui en faire honorablement un grand bûcher et réduire son corps en cendres ; puis il lui éleva une colonne comme au Père de la patrie (ainsi portait le chapiteau), et enfin il lui rendit plus d’honneur, tout mort qu’il était, qu’il n’en aurait dû rendre à homme du monde, si ce n’est à ceux qui l’avaient tué. Les empereurs romains n’oubliaient pas surtout de prendre le titre de tribun du peuple, tant parce que cet office était considéré comme saint et sacré, que parce qu’il était établi pour la défense et protection du peuple et qu’il était le plus en faveur dans l’état. Par ce moyen ils s’assuraient que ce peuple se fierait plus à eux, comme s’il lui suffisait d’ouïr le nom de cette magistrature, sans en ressentir les effets.
Mais ils ne font guère mieux ceux d’aujourd’hui, qui avant de commettre leurs crimes, même les plus révoltants les font toujours précéder de quelques jolis discours sur le bien général, l’ordre public et le soulagement des malheureux. Vous connaissez fort bien le formulaire dont ils ont fait si souvent et si perfidement usage. Et bien, dans certains d’entre eux, il n’y a même plus de place à la finesse tant et si grande est leur impudence. Les rois d’Assyrie, et, après eux, les rois Mèdes, ne paraissaient en public que le plus tard possible, pour faire supposer au peuple qu’il y avait en eux quelque chose de surhumain et laisser en cette rêverie les gens qui se montent l’imagination sur les choses qu’ils n’ont point encore vues. Ainsi tant de nations, qui furent assez longtemps sous l’empire de ces rois mystérieux, s’habituèrent à les servir, et les servaient d’autant plus volontiers qu’ils ignoraient quel était leur maître, ou même s’ils en avaient un ; de manière qu’ils vivaient ainsi dans la crainte d’un être que personne n’avait vu.
Les premiers rois d’Égypte ne se montraient guère sans porter, tantôt une branche, tantôt du feu sur la tête : ils se masquaient ainsi et se transformaient en bateleurs. Et cela pour inspirer, par ces formes étranges, respect et admiration à leurs sujets, qui, s’ils n’eussent pas été si stupides ou si avilis, n’auraient dû que s’en moquer et en rire. C’est vraiment pitoyable d’ouïr parler de tout ce que faisaient les tyrans du temps passé pour fonder leur tyrannie ; de combien de petits moyens ils se servaient pour cela, trouvant toujours la multitude ignorante tellement disposée à leur gré, qu’ils n’avaient qu’à tendre un piège à sa crédulité pour qu’elle vînt s’y prendre ; aussi n’ont-ils jamais eu plus de facilité à la tromper et ne l’ont jamais mieux asservie, que lorsqu’ils s’en moquaient le plus.
Que dirai-je d’une autre sornette que les peuples anciens prirent pour une vérité avérée. Ils crurent fermement que l’orteil de Pyrrhus, roi d’Épire, faisait des miracles et guérissait des maladies de la rate. Ils enjolivèrent encore mieux ce conte, en ajoutant : que lorsqu’on eût brûlé le cadavre de ce roi, cet orteil se trouva dans les cendres, intact et non atteint par le feu. Le peuple a toujours ainsi sottement fabriqué lui-même des contes mensongers, pour y ajouter ensuite une foi incroyable. Bon nombre d’auteurs les ont écrits et répétés, mais de telle façon qu’il est aisé de voir qu’ils les ont ramassés dans les rues et carrefours. […]
(Étienne de La Boétie, Discours de la servitude volontaire, 1727)
Extrait : Mémoire sur la pacification des troubles d’Étienne de La Boétie
Conseiller au parlement de Bordeaux, La Boétie s’est toujours intéressé aux questions politiques, sur lesquelles il a laissé de nombreux mémoires. Ici, il s’intéresse aux causes du schisme survenu au début de son siècle dans l’Église, dont les conséquences politiques sont connues. Dans un style argumentatif qui n’exclut pas une chaleur due à l’implication personnelle (La Boétie n’est pas à l’aise avec les abstractions), il attribue la responsabilité de la dissidence au scandale créé par la corruption des ecclésiastiques catholiques, mais aussi aux réactions maladroites du pape : « pour vouloir tout garder, on perd tout ».
Qui a rompeu ceste paix et a mis toute l’Europpe en combustion ? L’un nommera Martin [Luther], l’autre Zuingle, l’autre quelqu’un des chefz de leur doctrine, mais ce n’est pas ce que je cerche. Le mal se couvoit devant que ceux la nasquissent ; et encores qu’ilz ayent esté les instrumens pour esmouvoir la noise, si peust il qu’il faut prandre la cause de plus hault ; et me semble comme il advient quand on a quelque mauvaise aposteme et fort enflammée, laquelle on craint de faire percer au chirurgien, bien qu’elle soit meure, que souvant par rencontre on vient à heurter quelcun qui, ou par fortune ou par envye qu’il a de faire mal, la fait crever, et aveques grande douleur, mais toutefois pour le bien et advantage de celluy qui reçoit le coup. Ainsi il est aisé à cognoistre que l’Esglize, estant long temps y a merveilleusement corrompeue d’inffinis abuz, survenus tant par la longueur du temps que par la dissolution des meurs, ne pouvant plus elle mesme se contenir en soy et s’estant venue la malladie en son entiere maturité, elle a rencontré ces gens là, toute asseurée si elle n’eust trouvé ceux là, d’en trouver d’autres. Il est bien possible que, par aventure, ilz eussent mieux fait et plus gratieusement cet office, avecque plus de modestie, de prudence et de bonne intention ; mais, cependant, l’esglize doibt avoir senty que, soit de la main amie ou ennemye, elle a esté en quelque endroit touchee là où estoit vrayement le mal qu’il falloit purger. Reste donques que sans doubte les abus de l’Esglize ont esté l’occasion qui a donné tant de vigueur au feu qui est maintenant alumé. Le peuple n’a pas moien de juger, estant despourveu de ce qui donne ou confirme le bon jugement, les lettres, les discours et l’experiance. Puisqu’il ne peut juger, il croit autruy. Or, est cella ordinaire que la multitude croit plus aux personnes qu’aux choses, et qu’il est plus persuadé par l’authorité de celluy qui parle que par les raisons qu’il dit, et ne faut doubter qu’en son endroit, les impressions qu’il prend de ce qu’il voit des yeux corporelz n’aient plus de pouvoir que les plus subtilles disputes et les plus vifz argumens du monde. Car son principal entendement consiste aux sens naturelz et non en l’esprit.
Ainsi le peuple, oyant les invectives que faisoint contre les esclesiasticques ceux qui s’estoint despartis de l’Esglize, ilz ont prins garde aux vices manifestes du clergé, à la mauvaise vie, l’embission, la villenye, avarisse de plusieurs ; et ayant trouvé cella veritable que les autres en avoint dit, ilz ont ayseement creu que la doctrine estoit fauce de ceux qui vivoint si mal, et commectoint des abus si grossiers, et au contraire, que la doctrine de leurs adversaires estoit vraye, les ayans trouvez veritables en ce qu’ilz leur avoint dit de la disolution des meurs. Par ce moien, ayans commencé à mespriser leurs prelatz et perdu la reverance qu’ilz avoient à l’Esglize, ilz n’ont plus escouté leur priere, l’ayans à desdaing accause de ces pasteurs, et ainsi la pluspart ont laissé une cause qu’ilz n’entendoint point, comme plusieurs juges qui, par un zelle indiscret, cognoissans une partie de mauvaise foy et grand plaideur, condemnent la cause pour la personne sans avoir cogneu de droit.
Ainsi l’origine de ceste calamité c’est l’abus des eclesiasticques et la mauvaise vie et insufisance des pasteurs qui estoit si grande et si notoire qu’elle a esmeu ceste querelle, et a servy d’un argument invincible à leurs adversaires ; et de cella en est un tesmognage certain, si on veut se resouvenir où se print premierement le feu. Ce fut, je croys, aux indulgences l’an 1517, pour ce que de ce cousté là sans doubte l’Esglize estoit si taree, qu’il estoit impossible de couvrir ceste deformité sans trop grande impudense. Or, la mal a toujours creu, et cela pour autant qu’au lieu que le chef de l’Esglize debvoit avoir congneu le vice et s’aviser de rabiller promptement ce default, ilz firent tout le rebours, et au contraire de ceux qui voyant la flamme alumee, abatent ce qui est près, mesmes s’il est de bois et subject à brusler. Car en lieu d’estre advertis par ce commencement des abus qui estoit parmy eux, d’ouster celluy là où Lhuter s’estoit attacquee et encore les autres, à fin de ne luy donner prinse sur eux, ilz s’opiniastrarent sans cause à maintenir celluy là, attisant le feu par ce moien et luy donnant alimentation et nourriture ; de sorte que despuis, s’estant embrazé vifvement, il a consommé non seulement ce qui estoit de ce bastimant gasté et vicieux, mais encore de celluy là mesme ce qui estoit bon et solide et bien fondé.
Si Pappe Leon, dès le commencement, eut habillement assemblé le consille et receu Martin [Luther] à debattre, et recogneu les fautes notoires et retranché les manifestes abus, nous ne fussions pas maintenant en ceste maleureuse perturbation de toutes choses. Mais c’est ce qu’on dit que souvant, pour vouloir tout garder, on perd tout, et pour ne se vouloir point despartir des fauces coustumes introduites par avarise en l’Esglize, on a donné occasion aux ennemys d’esbranler les bonnes et saintes traditions, et que noz bons et religieux peres nous avoint laissées. Aussy de nostre part, en France, nous aydames beaucoup à avancer la ruine, quand en lieu de remettre sus la vraye et antienne eslection des pasteurs, et la corriger, nous l’ostames du tout. Et de malheur, ce fut lors que Martin commensa d’entrer en lice, qui n’estoit autre chose sinon, à l’heure que l’ennemy estoit en campaigne et qu’il falloit renforcer les garnisons, les casser du tout et ouvrir les portes.
(Étienne de La Boétie, Mémoire sur la pacification des troubles, Paris, Droz, 1983)
📽 15 citations choisies d’Étienne de La Boétie
- L’amitié naît d’une mutuelle estime et s’entretient moins par les bienfaits que par l’honnêteté. (Discours de la servitude volontaire, 1576)
- Il y a trois sortes de tyrans. Les uns règnent par l’élection du peuple, les autres par la force des armes, les derniers par succession de race. (Discours de la servitude volontaire, 1576)
- La liberté est donc naturelle ; c’est pourquoi, à mon avis, nous ne sommes pas seulement nés qu’avec elle mais avec la passion de la défendre. (Discours de la servitude volontaire, 1576)
- Ce qui rend un ami sûr de l’autre, c’est la connaissance de son intégrité. Il en a pour garants son bon naturel, sa fidélité, sa constance. (Discours de la servitude volontaire, 1576)
- Il ne peut entrer dans l’esprit de personne que la nature ait mis quiconque en servitude puisqu’elle nous a tous mis en compagnie. (Discours de la servitude volontaire, 1576)
- Les semences de bien que la nature met en nous sont si frêles et si minces, qu’elles ne peuvent résister au moindre choc des passions ni à l’influence d’une éducation qui les contrarie. (Discours de la servitude volontaire, 1576)
- La liberté, les hommes la dédaignent uniquement, semble-t-il, parce que s’ils la désiraient, ils l’auraient ; comme s’ils refusaient de faire cette précieuse acquisition parce qu’elle est trop aisée. (Discours de la servitude volontaire, 1576)
- Mais certes tous les hommes, tant qu’ils ont quelque chose d’homme, devant qu’ils se laissent assujettir, il faut l’un des deux, qu’ils soient contraints ou déçus (…). (Discours de la servitude volontaire, 1576)
- Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. (Discours de la servitude volontaire, 1576)
- Soyez résolus de ne servir plus, et vous voilà libres. (Discours de la servitude volontaire, 1576)
- La première raison pour laquelle les hommes servent volontiers, est qu’ils naissent serfs et sont nourris tels. (Discours de la servitude volontaire, 1576)
- On ne regrette jamais ce qu’on n’a jamais eu ; et le regret ne vient point, sinon après le plaisir, et est toujours, avec la connaissance du bien, le souvenir de la joie passée. (Discours de la servitude volontaire, 1576)
- Qu’une nation ne fasse aucun effort, si elle veut, pour son bonheur, mais qu’elle ne travaille pas elle-même à sa ruine. (Discours de la servitude volontaire, 1576)
- Chacun parla d’amour ainsi qu’il l’entendit.
Je dis ce que mon cœur, ce que mon mal me dit,
Que celui aime peu, qui aime à la mesure. (Sonnets, XL) - J’aime ce qui me nourrit : le boire, le manger, les livres.
→ Autres citations d’Étienne de La Boétie.
Œuvres
- Œuvres complètes, William Blake & Co., 1991.
- Mémoire touchant l’Édit de janvier 1562.
- Discours de la servitude volontaire, Paris, Mille et Une Nuits, 1997.
- Discours de la servitude volontaire, Paris, Flammarion, 1993.
- Discours de la servitude volontaire, Paris, Payot, coll. « Petite bibliothèque », 2002.
Articles connexes
- Auteurs du XVIe siècle.
- Histoire de la France : L’Ancien Régime.
- Histoire de la littérature française du XVIe siècle.
- La Boétie : Discours de la servitude volontaire (1576).
- L’essai. – Le pamphlet.
- Genre littéraire : La poésie.
- Les Mémoires.
- Biographie de Montaigne.
- Lumière sur les Essais (1580) de Montaigne.
- Genres de poésie : Le sonnet.
- Courants littéraires du XVIe siècle : L’Humanisme. – La Pléiade.
Suggestion de livres
 La Servitude volontaire |  Discours de la servitude volontaire |  Discours de la servitude volontaire (Philo) |  Poésies complètes |