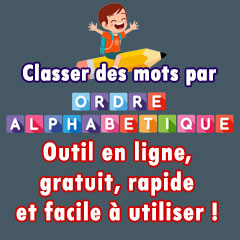Montesquieu : Lettres persanes (1721)
Lumière sur… / L’univers des livres► vous êtes ici
Lumière sur…
Lettres persanes (1721)
– Montesquieu –
Sommaire

Lettres persanes est un roman épistolaire de Montesquieu, publié sans nom d’auteur en 1721. Au XVIIIe siècle, l’Orient et le goût des voyages sont à la mode. Cependant, le recueil était resté anonyme parce que cela permettait à l’auteur de critiquer la société française sans risquer la censure. Les Lettres persanes sont l’un des textes fondateurs de la littérature et de la pensée des Lumières.
→ Lire la biographie de Montesquieu.
La France du XVIIIe siècle vue par deux voyageurs persans ou la relativité des mœurs au service de la critique
Mars 1711. Usbek, riche Persan d’Ispahan, homme cultivé et possesseur d’un important sérail, décide, pour parfaire ses connaissances, de faire un voyage en Europe. Accompagné d’un ami plus jeune et sans attaches, Rica, il met près de quatorze mois à traverser la Turquie, puis la Méditerranée, et arrive à Paris en mai 1712. Le lecteur n’est averti des péripéties du voyage, puis des modalités du séjour (qui durera huit ans et demi) que par l’intermédiaire des lettres (161 en tout, datées de 1711 à 1720) que les deux Persans échangent entre eux ou avec leurs compatriotes, soit restés en Orient (femmes et eunuques du sérail d’Usbek, amis, dignitaires musulmans) soit eux-mêmes en résidence à Livourne, à Venise, en Moscovie. Il épouse ainsi le regard que des gens intelligents et curieux, mais non avertis, peuvent jeter sur tout ce qui lui semblait aller de soi : mœurs, coutumes, opinions, hiérarchies ; et il prend conscience de leur caractère relatif, arbitraire, convenu, discutable, voire ridicule.
Comme Usbek est surtout préoccupé de théorie politique (il cherche à savoir quel est le meilleur gouvernement possible) et Rica de curiosités pratiques (il regarde vivre les Français et trouve de quoi s’étonner), l’orientation générale du roman est double : satirique et cocasse d’une part, et d’autre part réflexive et théorique. Double aussi l’intrigue, puisque, pendant cette longue absence du maître, le sérail d’Usbek connaît bien des vicissitudes ; ainsi la correspondance qui part de France nous met au fait des découvertes des deux voyageurs et des questions qu’elles leur posent, et celle qui vient de Perse nous fait assister aux efforts vains que, de loin, Usbek déploie pour maintenir l’ordre parmi ses femmes et l’obéissance parmi ses eunuques. Une double catastrophe clôt l’ouvrage : à Paris, c’est l’effondrement du « Système » bancaire de Law qui ruine l’économie, démoralise la société, compromet la remise en ordre politique entreprise par le Régent depuis 1715 ; à Ispahan, c’est la trahison de la favorite Roxane qui met le comble au désordre. Elle a le dernier mot du livre, annonçant à Usbek qu’elle a fait de son sérail un bain de sang, qu’elle se tue elle-même, et qu’elle reste à jamais ce qu’elle a toujours été en face de lui : libre.
Roman et philosophie : une œuvre emblématique des Lumières
L’extraordinaire succès remporté par le livre à sa publication, sa valeur de référence acquise depuis, sont dus à deux caractéristiques à première vue contradictoires : la verve sautillante de la revue drolatique qui fait défiler, sous l’œil amusé des Persans, individus, types et institutions de la société française, mille et une folies, inconséquences et inepties ; le caractère sérieux et philosophiquement armé de l’enquête politique (négativité des principes du despotisme, nécessaire laïcisation de la dimension religieuse, nouvelles finalités : équilibre des pouvoirs, progression démographique, liberté individuelle). Il faut dire que, pour la première fois en France, on présentait la question du gouvernement comme susceptible d’une approche rationnelle, non plus théologique mais scientifique. C’est déjà, si l’on veut, la démarche qui sera celle de De l’esprit des lois, vingt-sept ans après (1748).
La critique s’est partagée sur la part qu’il fallait faire, dans cette œuvre, à la fantaisie romanesque et à l’élaboration idéologique. Montesquieu a lui-même suggéré qu’une « chaîne secrète » reliait ces deux dimensions. Il est certain que ce jeune auteur de trente-deux ans a trouvé la formule idéale pour faire valoir ensemble le plaisir du jeu de massacre et l’intérêt d’un questionnement patient, méthodique, documenté sur ce que l’on peut appeler aujourd’hui, après Montesquieu et grâce à lui, une sociologie politique. L’exemple le plus célèbre de cette formule — qui devait rester, avec Les Provinciales de Blaise Pascal et les meilleures pages de Voltaire, l’un des modèles légendaires de la grande prose française — est l’apologue des Troglodytes qu’Usbek conte à son ami Mirza dans les lettres XI à XIV. Sous les dehors légers de la fable on y trouve la démarche expérimentale complète d’un peuple qui, après avoir éprouvé les méfaits de la violence anarchique, connaît les bienfaits de la fraternité et du partage « républicains », puis se laisse aller, par manque d’énergie morale, à souhaiter un pouvoir monarchique. L’apologue d’Usbek nous laisse au seuil de ce dernier essai, dont ceux qui avaient connu les dernières années du règne de Louis XIV pouvaient juger les résultats.
Extrait : Lettre XXIV
Après plusieurs mois de voyage, Usbek et Rica sont enfin parvenus en France. La première lettre adressée de Paris est pleine de l’émerveillement des deux voyageurs. Le sujet de leur surprise sont ici les préoccupations de Montesquieu qui pointe du doigt les difficultés financières à la fin du règne de Louis XIV. L’innocence des deux « mahomettans » permet aussi de porter un regard critique sur l’omnipotence de l’Église et son emprise sur les esprits.
[…] Le roi de France est le plus puissant prince de l’Europe. Il n’a point de mines d’or comme le roi d’Espagne, son voisin ; mais il a plus de richesses que lui parce qu’il les tire de la vanité de ses sujets, plus inépuisable que les mines. On lui a vu entreprendre ou soutenir de grandes guerres, n’ayant d’autres fonds que des titres d’honneur à vendre, et par un prodige de l’orgueil humain, ses troupes se trouvaient payées ; ses places, munies, et ses flottes, équipées.
D’ailleurs ce roi est un grand magicien : il exerce son empire sur l’esprit même de ses sujets ; il les fait penser comme il veut. S’il n’a qu’un million d’écus dans son trésor, et qu’il en ait besoin de deux, il n’a qu’à leur persuader qu’un écu en vaut deux, et ils le croient. S’il a une guerre difficile à soutenir, et qu’il n’ait point d’argent, il n’a qu’à leur mettre dans la tête qu’un morceau de papier est de l’argent, et ils en sont aussitôt convaincus. Il va même jusqu’à leur faire croire qu’il les guérit de toutes sortes de maux en les touchant, tant est grande la force et la puissance qu’il a sur les esprits.
Ce que je te dis de ce prince ne doit pas t’étonner : il y a un autre magicien, plus fort que lui, qui n’est pas moins maître de son esprit qu’il l’est lui-même de celui des autres. Ce magicien s’appelle le Pape. Tantôt il lui fait croire que trois ne sont qu’un, que le pain qu’on mange n’est pas du pain, ou que le vin qu’on boit n’est pas du vin, et mille autres choses de cette espèce.
Et, pour le tenir toujours en haleine et ne point lui laisser perdre l’habitude de croire, il lui donne de temps en temps, pour l’exercer, de certains articles de croyance. Il y a deux ans qu’il lui envoya un grand écrit, qu’il appela Constitution, et voulut obliger sous de grandes peines, ce prince et ses sujets de croire tout ce qui y était contenu. Il réussit à l’égard du Prince, qui se soumit aussitôt et donna l’exemple à ses sujets. Mais quelques-uns d’entre eux se révoltèrent et dirent qu’ils ne voulaient rien croire de tout ce qui était dans cet écrit. Ce sont les femmes qui ont été motrices de toute cette révolte, qui divise toute la Cour, tout le Royaume et toutes les familles. Cette Constitution leur défend de lire un livre que tous les Chrétiens disent avoir été apporté du ciel : c’est proprement leur Alcoran. Les femmes, indignées de l’outrage fait à leur sexe, soulèvent tout contre la Constitution ; elles ont mis les hommes de leur parti, qui, dans cette occasion, ne veulent point avoir de privilège. On doit pourtant avouer que ce moufti ne raisonne pas mal, et, par le grand Hali, il faut qu’il ait été instruit des principes de notre sainte loi. Car, puisque les femmes sont d’une créature inférieure à la nôtre, et que nos prophètes nous disent qu’elles n’entreront point dans la Paradis, pourquoi faut-il qu’elles se mêlent de lire un livre qui n’est fait que pour apprendre le chemin du Paradis ? […]
(Montesquieu, Lettres persanes, Paris, Librairie générale française, coll. « Livre de Poche », 1984)
📽 15 citations choisies de Montesquieu
Articles connexes
- Rubrique du site : Lumière sur…
- Biographie de Montesquieu. – Auteurs du XVIIIe siècle.
- Le roman épistolaire ou par lettres.
- Les genres romanesques.
- Analyser une lettre. – Analyser un roman.
- Fiche technique : La lettre.
- Les règles de rédaction d’une lettre.
- La correspondance : échange de lettres réelles.
- L’essai. – La satire.
- Œuvres au programme du bac de français 2020.
- Le Siècle des Lumières (XVIIIe siècle).
- Les genres littéraires et les genres de textes.
- L’univers des livres » Œuvres littéraires.
- Histoire de la langue française.
- Qu’est-ce que la littérature ?
Suggestion de livres
 Lettres persanes (clés d’analyse pour le bac) |  Lettres persanes (Bac) |  Lettres persanes (l’œuvre et son parcours) |  Étude sur Lettres persanes |