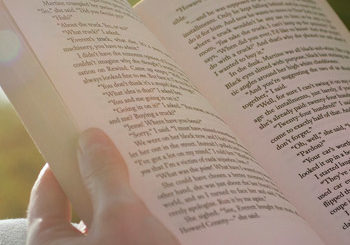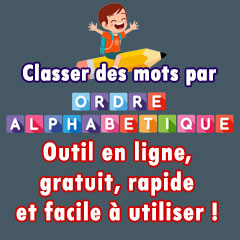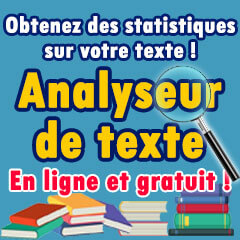Molière
Auteurs français ► XVIIe siècle ► vous êtes ici
Auteurs français
Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière
1622 – 1673
Sommaire
Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, baptisé le 15 janvier 1622 à l’église Saint-Eustache de Paris et mort le soir du 17 février 1673 à son domicile de la rue de Richelieu, est le plus célèbre des comédiens et dramaturges de langue française.
Présentation
Molière est dramaturge, directeur de troupe et acteur français qui a fixé le modèle de la comédie classique et qui incarne l’auteur classique français par excellence.
Si les quelque trente pièces que Molière écrivit se caractérisent par leur diversité — farces, comédies d’intrigues, comédies-ballets, grandes comédies, pièces à machines —, elles trouvent leur unité dans le rire. Le comique moliéresque a traversé les siècles : certains de ses personnages sont devenus des archétypes, ses pièces sont très souvent mises en scène et il tient une place majeure dans l’enseignement actuel.
→ À lire : Les personnages littéraires dans la langue française. – Don Juan. – La farce. – La comédie. – La comédie classique en France.
→ Œuvres de Molière : Les Précieuses ridicules (1659) – Le Médecin malgré lui (1666) – Le Malade imaginaire (1673).
Les débuts
De son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin, Molière naquit à Paris le 15 janvier 1622. Il était le fils d’un bourgeois parisien aisé possédant la charge de tapissier du roi, c’est-à-dire de fournisseur officiel de la Cour. Son enfance fut marquée par des deuils successifs, dont le plus pénible fut la mort de sa mère, en 1632. Il fut élève des jésuites au collège de Clermont, que fréquentaient les fils de l’aristocratie et de la grande bourgeoisie, puis fit des études de droit pour devenir avocat (1640), titre qui permettait alors l’achat d’une charge dans la justice ou l’administration.
L’illustre-Théâtre
 Molière ne profita pourtant pas de la possibilité de promotion sociale qui lui était offerte car, dès 1643, il décida, contre l’avis de son père, de devenir comédien. La même année, avec sa maîtresse Madeleine Béjart, la famille de celle-ci et quelques autres comédiens, il fonda une compagnie théâtrale, baptisée l’Illustre-Théâtre.
Molière ne profita pourtant pas de la possibilité de promotion sociale qui lui était offerte car, dès 1643, il décida, contre l’avis de son père, de devenir comédien. La même année, avec sa maîtresse Madeleine Béjart, la famille de celle-ci et quelques autres comédiens, il fonda une compagnie théâtrale, baptisée l’Illustre-Théâtre.Tournées en province
Succès parisiens
Succès et controverses
L’École des Femmes
Invité à la cour pour y faire représenter ses œuvres, Molière suscita dès ce moment des jalousies, qui se manifestèrent avec un éclat particulier au lendemain de la création d’une de ses comédies les plus réussies, L’École des femmes (1662). Le sujet de cette pièce, qui soulevait des questions importantes (l’institution du mariage et l’éducation des filles), tranchait nettement avec les thèmes habituels de la farce ou de la comédie à l’italienne. Innovation littéraire en même temps que critique originale de la société du temps, elle irrita certains auteurs concurrents autant qu’elle choqua les tenants de la morale traditionnelle. Elle eut cependant un succès retentissant, ce qui ne contribua pas à apaiser le débat.
Tartuffe et Dom Juan
Divertissements royaux
Ce sont ces liens privilégiés avec la cour qui expliquent l’importance dans l’œuvre de Molière du genre de la comédie-ballet, spectacle mêlant musique, danse et théâtre.
Fin de Molière
En 1680, par ordre du roi, la troupe de Molière fut réunie avec sa concurrente de l’Hôtel de Bourgogne pour fonder la Comédie-Française.
Œuvre de Molière
Contrairement à ce que certains aspects de sa légende font valoir, la double carrière de Molière, acteur et auteur dramatique, fut une exceptionnelle réussite. Les difficultés, morales et matérielles, qu’il rencontra comme directeur de troupe et comme écrivain ne doivent pas occulter, en effet, l’extraordinaire succès qu’il connut de son vivant, aussi bien auprès du public et de la cour qu’auprès des autres écrivains. Ce succès fut l’effet de son génie comique d’acteur (ses mimiques, sa capacité d’imitateur), de la qualité de sa troupe (où se formèrent des acteurs importants, comme Baron ou la Du Parc) mais aussi, bien sûr, de la création de textes dramatiques puissants.
Molière créa son œuvre dramatique en faisant la synthèse de nombreux héritages dont les principaux sont la farce dans la plus pure tradition gauloise, la comédie italienne et la comédie psychologique. La variété des noms des personnages moliéresques constitue la marque la plus visible de ce travail de synthèse, par lequel il mêla les apports de différentes cultures.
Le « premier farceur de France »
Aux noms populaires français qui émaillent les pièces de Molière – ceux des jeunes paysans dans Dom Juan, par exemple – correspond la tradition de la farce.
Représentant des situations inspirées de la vie quotidienne la plus triviale (scènes de ménage, adultères, vols, tromperies), la farce était traditionnellement fondée sur un comique d’action et de situation, et mettait en scène des personnages immuables, des types humains au caractère figé (épouse infidèle, marchand malhonnête, moine débauché, etc.). Molière, bien qu’il se défendît d’être, selon le mot d’un de ses contemporains, « le premier farceur de France », écrivit des pièces qui sont des farces à part entière, telles que Le Médecin volant ou Le Médecin malgré lui, et trouva dans le genre la marque de son style comique.
La farce était alors un genre jugé vulgaire et n’était plus guère à la mode : on ne la jouait plus que comme complément de programme, après avoir représenté une grande pièce (tragédie ou comédie). Molière triompha pourtant dans le genre et le fit revenir à la mode avec sa pièce Les Précieuses ridicules, qui en renouvelle les thèmes et le rend plus actuel. Il utilisa volontiers les procédés caractéristiques de la farce dans de nombreuses autres pièces (plaisanteries scatologiques dans Monsieur de Pourceaugnac), et même dans ses comédies soutenues (Orgon sous la table et pas loin du cocuage dans Tartuffe, le sac et les coups de bâton dans Les Fourberies de Scapin).
→ À lire : La farce. – La comédie classique en France.
L’héritier de la comédie italienne
D’autres noms de personnages de Molière sont empruntés visiblement aux auteurs italiens qui reprirent la comédie latine pour l’enrichir des jeux de scène outrés et comiques de la commedia dell’arte. Molière utilisa parfois directement des sources latines : ainsi, sa comédie L’Avare est inspirée de La Marmite de Plaute. Mais c’est aux Italiens qu’il emprunta l’habitude de se grimer et la virtuosité stéréotypée de ses mimiques, de ses roulements d’yeux et de ses jeux de scène. C’est dans le plus pur esprit de la commedia dell’arte qu’il interprétait les personnages comiques ou ridicules comme, par exemple, celui de Sganarelle, dont il se réservait toujours le rôle et qui revient dans plusieurs pièces (où il incarne des êtres de condition inférieure et de peu d’esprit : le valet couard, le vieillard cocu, etc.).
Aux Italiens, Molière doit aussi les personnages-types de ses comédies d’intrigue (le vieillard amoureux, le jeune premier maladroit, le valet débrouillard, etc.) et les trois schémas dramatiques qui structurent la plupart de ses pièces. Le premier de ces schémas était déjà présent dans la comédie latine : c’est celui de l’amour du jeune homme empêché par le vieillard. Chez Molière, l’esclave antique est remplacé par un valet, le vieillard connaît des métamorphoses modernes et la courtisane devient une jeune fille très amoureuse mais respectable (dont le rôle prend en outre une importance qu’il n’avait pas chez les auteurs latins). C’est sur ce schéma que sont écrites des pièces telles que L’Amour médecin mais aussi L’Avare ou Les Fourberies de Scapin (où le schéma se dédouble avec non pas un, mais deux couples de jeunes premiers).
Le second schéma est celui du contretemps, qui caractérise Le Dépit amoureux mais aussi Le Misanthrope. Le troisième est celui de la revue, qui se présente comme un défilé de personnages variés : on en trouve des traces dans Le Bourgeois gentilhomme.
Enfin, nombreux sont les dénouements des pièces de Molière qui paraissent peu vraisemblables, surtout pour le spectateur moderne : là aussi, l’auteur réutilise à sa manière un procédé traditionnel, celui de la « reconnaissance », dont parlait déjà Aristote et qui est une scène où l’intrigue se dénoue brusquement sur la révélation de l’identité ou de l’histoire familiale des protagonistes.
Quelques noms espagnols rappellent également ce que le théâtre français doit à ce pays : Dom Juan a pour ancêtre une pièce religieuse de Tirso de Molina, Le Trompeur de Séville, mais parodie aussi l’univers de la tragi-comédie au cadre espagnol.
Les « caractères » et la tradition des moralistes
Beaucoup de noms de personnages de Molière sont empruntés au grec ancien (parfois via l’italien), ce qui nous rappelle que, pour les classiques, le théâtre met en scène des « caractères » au sens que les traducteurs de Théophraste donnèrent à ce mot.
Ainsi, Harpagon est le type de l’« avare » et l’avarice est également attachée, selon la tradition, au caractère de son âge, la vieillesse. Comme l’indiquent le titre et le sous-titre de la pièce Le Misanthrope ou L’Atrabilaire amoureux, Alceste incarne le « misanthrope », état d’esprit lié à l’humeur mélancolique de la bile noire qui domine les « atrabilaires ». Or, quand un vieillard est amoureux d’une jeune fille, quand un atrabilaire est amoureux d’une femme mondaine, il sera forcément ridicule, autant qu’une femme qui veut faire la savante (Les Femmes savantes) ou qu’un bourgeois qui se prend pour un gentilhomme ou un apôtre (Le Bourgeois gentilhomme).
Molière utilise ces caractères avec une visée moraliste : ses pièces mettent en scène les multiples visages de la déraison face à l’unique caractère de la raison, celui de l’« honnête homme », qui est représenté tantôt par le personnage du « raisonneur », tantôt par tel bourgeois ou telle servante au bon sens populaire.
Molière peintre de son siècle
Ce n’est pas Molière mais Pierre Corneille qui, dès les années 1630, inventa une formule comique propre à peindre la réalité contemporaine. Corneille reprend en effet au genre pastoral des personnages et des schémas d’action (A aime B qui aime C, par exemple, schéma que Jean Racine utilisera encore dans ses tragédies) pour évoquer non plus les bergers et bergères d’un monde de fantaisie, mais la jeunesse dorée de son époque évoluant dans des lieux parisiens à la mode.
Cependant, c’est d’une manière bien différente que Molière utilise ces schémas. Lui met l’accent sur le réalisme pour proposer tantôt une satire sociale traditionnelle (le pédant, la fausse prude, le père avare et le fils prodigue, etc.), tantôt la peinture de types sociaux nouveaux (le petit marquis, le poète mondain et le « docte », l’homme de lois, la précieuse, le dévot insensible, etc.).
Avec ses comédies de mœurs, il porte ainsi sur la scène les problèmes qui se posent aux « morales du Grand Siècle » dont parle Paul Bénichou. C’est ce qui lui valut le surnom de « peintre » de la part de quelques-uns de ses contemporains, fascinés par le miroir qu’il leur tendait. En outre, les « querelles » qu’il suscita n’étaient pas seulement littéraires : à ce titre, elles sont significatives et mettent au jour les contradictions de l’idéologie de la France classique.
Le créateur de la « grande comédie » et de la « comédie-ballet »
La grande comédie
Au temps où Molière écrivait, la comédie soutenue avait des modèles italiens et Corneille en avait déjà posé les bases, notamment l’écriture en vers et la division en cinq actes, qui en faisaient la sœur de la tragédie classique. Mais c’est Molière qui fournit le modèle d’un nouveau type de « grande comédie », libérée des contraintes de l’esthétique classique, et qui, par le rire, avait pour fonction d’édifier le public, de le gagner aux valeurs de la sincérité et de la tolérance.
Inaugurée avec éclat par le succès de L’École des femmes, la grande comédie, si on la définit dans le sens strict que lui donna Corneille, est illustrée par peu de pièces dans l’œuvre de Molière (Le Tartuffe, Le Misanthrope et Les Femmes savantes) car une pièce comme L’École des maris n’a que trois actes, L’Avare est en prose, Les Fourberies de Scapin sont d’un ton moins élevé. Quant à Dom Juan, la plus moderne et la plus représentée des pièces de Molière, qui passe souvent pour être aussi la plus profonde, elle doit être mise à part: on a souvent dit qu’elle témoignait du goût de Molière pour le mélange des genres et qu’elle faisait de cet auteur classique un adepte incontestable de l’esthétique baroque. En réalité, son apparente irrégularité provient de ce qu’elle appartient à un genre particulier, celui du « théâtre à machines ».
Malgré leurs irrégularités par rapport à la norme classique, ces pièces de Molière qui traitent de sujets graves sous le couvert du rire – contraintes sociales brimant l’individu, angoisse de la jalousie, de la vieillesse, de la maladie et de la mort, désir de liberté absolue, etc. – ont une portée suffisante pour mériter le titre de « grandes comédies ».
Les comédies-ballets
Molière, ayant eu à écrire pour les réjouissances royales, créa des pièces qui devaient mêler au jeu d’acteurs un accompagnement musical et des intermèdes offrant les plaisirs du chant et de la danse (ces intermèdes étant liés ou non à la pièce). C’est ce qu’on appelle la comédie-ballet (inventée avec Les Fâcheux), mais on trouve dans cette catégorie des pièces appartenant à des genres très différents : comédie de mœurs avec intermèdes bouffons (Le Bourgeois gentilhomme), « tragédie-ballet » (Psyché), pastorale aristocratique (La Princesse d’Elide), pièce mythologique (Amphitryon), farce musicale (Monsieur de Pourceaugnac, George Dandin), etc. Dans chacune de ces pièces, Molière sut allier comédie et ballet avec une cohérence et une harmonie inégalées.
Pour aller plus loin…
→ Les Précieuses ridicules.
→ Le Médecin malgré lui.
→ La comédie.
→ La comédie classique en France.
→ Les querelles littéraires du XVe au XVIIIe siècles.
→ La commedia dell’arte.
→ Exercice : Connaissez-vous Molière ?
Bibliographie sélective
- La Jalousie du Barbouillé (v. 1646)
- Le Médecin volant (v. 1647)
- L’Étourdi (1654)
- Dépit amoureux (1656)
- Les Précieuses ridicules (1659)
- Sganarelle (1660)
- Dom Garcie de Navarre (1661)
- L’École des maris (1661)
- Les Fâcheux (1661)
- L’École des femmes (1662)
- Critique de l’École des femmes (1663)
- L’Impromptu de Versailles (1663)
- Le Mariage forcé (1664)
- La Princesse d’Élide (1664)
- Tartuffe (1664)
- Dom Juan (1665)
- L’Amour médecin (1665)
- Le Misanthrope (1666)
- Le Médecin malgré lui (1666)
- Mélicerte (1666)
- Pastorale comique (1667)
- Le Sicilien (1667)
- Amphitryon (1668)
- Georges Dandin (1668)
- L’Avare (1668)
- Monsieur de Pourceaugnac (1669)
- Les Amants magnifiques (1670)
- Le Bourgeois Gentilhomme (1670)
- Psyché (1671)
- Les Fourberies de Scapin (1671)
- La Comtesse d’Escarbagnas (1671)
- Les Femmes savantes (1672)
- Le Malade imaginaire (1673)
📽 20 citations choisies de Molière
- Je veux qu’on soit sincère, et qu’en homme d’honneur,
On ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. (Le Misanthrope) - Claudine : « Pour moi, je hais les maris soupçonneux, et j’en veux un qui ne s’épouvante de rien, un si plein de confiance, et sûr de ma chasteté, qu’il me vît sans inquiétude au milieu de trente hommes ». (George Dandin, Acte II ; scène 1)
- George Dandin : « […] lorsqu’on a, comme moi, épousé une méchante femme, le meilleur parti qu’on puisse prendre c’est de s’aller jeter dans l’eau la tête la première. » (George Dandin, Acte III ; scène 8)
- Bon droit a besoin d’aide. (La Comtesse d’Escarbagnas)
- Les anciens, monsieur, sont les anciens, et nous sommes les gens de maintenant. (Le Malade imaginaire)
- Mon Dieu, le plus souvent l’apparence déçoit :
Il ne faut pas toujours juger sur ce qu’on voit. (Tartuffe) - Tout le secret des armes ne consiste qu’en deux choses, à donner et à ne point recevoir. (Le Bourgeois Gentilhomme)
- Qui veut noyer son chien l’accuse de la rage. (les Femmes savantes)
- Ah ! pour être dévot, je n’en suis pas moins homme. (le Tartuffe)
- La vertu dans le monde est toujours poursuivie.
Les envieux mourront, mais non jamais l’envie. (Le Tartuffe) - On ne meurt qu’une fois, et c’est pour si longtemps. (Le Dépit amoureux, acte V, scène 3)
- Il vaut mieux encor être marié que mort. (Les Fourberies de Scapin)
- Ah ! qu’en termes galants ces choses-là sont mises ! (Le Misanthrope)
- Je te dis toujours la même chose, parce que c’est toujours la même chose ; et si ce n’était pas toujours la même chose, je ne dirais pas toujours la même chose. (Dom Juan)
→ Autres citations de Molière.
Articles connexes
- Auteurs du XVIIe siècle.
- Histoire de la France : L’Ancien Régime.
- Courant littéraire : Le Baroque. Le Classicisme.
- Le théâtre.
- La Comédie-Française ou le Théâtre-Français.
- La comédie.
- La comédie classique en France.
- Les procédés du comique.
- La farce.
- Histoire et règles de la tragédie.
- Exercice : Connaissez-vous Molière ?
- Lumière sur…
Suggestion de livres
 |  |
 |  |
[➕ Autres choix…]